« Quand la BU propose des services pour les cours en ligne des enseignants-chercheur », par Jennifer Wolfarth-Garcia


Le 11 juin 2020, Dominique Lahary et Anne Verneuil postaient sur le blog professionnel de Dominique Lahary, DLog, un long billet détaillant ses inquiétudes quant à l’avenir des bibliothèques. Si la période de confinement a, selon lui, permis de mettre en avant la nature indispensable des équipements de lecture publique, le caractère fragile, non obligatoire ou aléatoire, des budgets qui leur sont alloués et leur nécessaire adaptation au contexte risquent de mettre en péril l’efficience de leurs missions de service publique en réduisant drastiquement leur périmètre d’action.
Les fermetures des établissements et les restrictions imposées pendant ce confinement ont modifié le rapport que les publics entretiennent avec les bibliothèques. Des initiatives ont été mises en place dans l’urgence pour accompagner au mieux ces publics et ne pas rompre brutalement le lien entre établissement, population et territoire. Il a fallu repenser le modèle de bibliothèque tiers lieu tel qu’il était envisagé jusqu’à présent et tenter de faire fonctionner a minima les établissements malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire du pays. Les impératifs du déconfinement - distance de sécurité, désinfection des collections, rassemblements limités – n’ont pas rendu plus simple l’accès au livre, à la lecture ou aux activité culturelles, bien au contraire. Les protocoles sanitaires indispensable à la réouverture prévue le 11 mai 2020 ont modifié les modalités de fréquentation et d’emprunt et contribués à complexifier la situation. Ces bibliothèques entravées proposent désormais des services considérablement réduits.
Alors faut-il se réinventer ? Quel chemin tracer pour que la bibliothèque post-covid ne se transforme pas en simple guichet d’enregistrement et remplisse pleinement ses missions ?
Le décret du 24 mars 2020, modifié le 14 avril 2020, a annoncé la fermeture des établissements recevant du public. Ce décret d’application a résonné comme un coup de tonnerre pour les personnels des établissements culturels. En réaction, la plupart des bibliothèques de taille suffisante ont mis en place un certain nombre de mesures afin de garantir la continuité du service publique et l’accès le plus large possible aux collections et ressources.
Les bibliothèques et médiathèques ont, en effet, multiplié les initiatives et ont ainsi permis l’accès à tout ou partie de leur ressources, proposé des services innovants et exploité toutes les possibilités offertes par les outils numériques.
Innovantes et ludiques, comme « la BnF dans votre salon », ou pratiques à l’instar des makers parisiens, les initiatives les plus nombreuses ont concerné l’ouverture des ressources quand cela était possible. Un grand nombre d’établissements a ainsi fait le choix de laisser, pendant toute la durée du confinement, l’accès libre et gratuit à l’ensemble de ses ressources numériques. Outre l’avantage d’être utilisé par le grand public dans un objectif récréatif, cette action a eu comme conséquence directe pour la communauté scientifique de raviver le débat déjà largement entamé autour de l’Open source. Ainsi pour Vincent Hachard, directeur adjoint du SCD de l’université de Nantes, « […] cette crise montre à quel point le développement de la science ouverte par le dépôt des publications des chercheurs dans des archives ouvertes est indispensable ».
Autre conséquence de la crise, la multiplication des publications sur la Covid-19, scientifiques ou non, a également remis sur le devant de la scène, s’il en était besoin, le rôle des bibliothèques dans la lutte contre les fake news. De nombreux ateliers d’éducation à l’information avaient déjà eu lieu avant le confinement mais la profusion de contres informations sur le corona virus, des publications scientifiques hasardeuses ou incomplètes ou plus simplement la publication d’informations non vérifiées ont rendu indispensable l’accès à une information fiable.
Conséquence inattendue, les initiatives des lieux de culture, bibliothèques comprises, ont modifié la notion d’accessibilité universelle. Difficilement effective depuis sa promulgation en 2005, la loi a paradoxalement pris tout son sens lors de la période de confinement. Le développement des services à distance a eu pour conséquence d’élargir et d’organiser l’offre disponible et de favoriser l’accès aux ressources pour des personnes empêchées. L’Association des paralysés de France a d’ailleurs vigoureusement salué les efforts déployés par les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur.
S’il ne s’agit que d’exemples et qu’il est difficile de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des dispositions prises par les bibliothèques, il est notable que chacune d’elles a contribué à redéfinir ou à consolider la place des établissements de lecture publique dans les paysages politique et social. Présentes malgré les fermetures, les bibliothèques ont contribué à maintenir un lien social parfois fragile et à assurer l’accès à la culture. Elles ont permis de divertir et d’informer un public le plus large possible, ont participé à l’effort collectif et se sont imposées comme incontournables en contribuant largement à « tenir » pendant les mois d’enfermement.
Le déconfinement a inauguré une nouvelle période de turbulence.
Le 28 avril 2020 a été annoncée la réouverture des certains lieux culturels le 11 mai 2020. Les établissements de lecture publique ont fait partie de la première vague. Cette annonce du gouvernement a été diversement appréciée. Très attendue par les lecteurs, elle est, en revanche, à l’origine de nombreuses craintes chez les professionnels des bibliothèques.
Une fois la surprise de l’annonce passée, les différentes structures se sont organisées en vue d’une réouverture progressive. Afin d’aider les bibliothécaires et les élus locaux, l’abf a publié, dans un document très détaillée, une série de recommandations. L’association préconise la mise en place de quatre phases successives de déconfinement. Les modalités de la gestion des risques, sanitaires ou juridiques[1], les conditions indispensables à une réouverture sécurisée (respect des gestes barrières, adaptation des locaux, protection des personnes vulnérables et des personnels, …) sont précisées et le document met en lumière les difficultés qui ne manquent pas d’entraver le bon fonctionnement des établissements. La diversité des risques évoqués permet de se rendre compte de la complexité de l’entreprise. Très peu prises en compte par les tutelles, les bibliothèques présentent des particularités que l’abf ne manque pas de souligner et une adaptation des consignes générales de réouverture des ERP s’est avérée nécessaire selon la nature des territoires, des locaux, des publics et des collections. Les conditions imposées de réouverture ont modifié les notions de temps, d’espace et de mouvement en bibliothèque.
Le temps tout d’abord. Les bibliothèques passent de l’immédiateté, de l’instantanéité de l’emprunt ou de la consultation sur place au temps plus long de la commande. La désinfection des documents, vecteurs possible du virus, impose la mise en quarantaine des documents et un retour aux communications différées. Les documents doivent désormais être réservés à l’avance. Flâner dans les rayons n’est plus possible mettant à mal l’idée de sérendipité. La remise en cause de l’accès directe aux collections correspond à une remise en cause radicale de la bibliothèque telle qu’elle est pensée aujourd’hui et à un retour au fonctionnement des années 70. Un grand bond en arrière.
L’espace ensuite. La mise en quarantaine des documents, l’établissement de sens de circulation et le respect des gestes barrière supposent une modification de l’espace et une adaptation des locaux. On assiste à une remise en cause de l’architecture et de l’aménagement. Plus de grand fauteuil mais des surfaces lisses pour aider à la désinfection, plus de grand plateau mais des espaces individuels pour limiter les contaminations, etc. La bibliothèque n’est actuellement plus envisagée comme un lieu où l’on reste, où l’on stationne. Elle est un lieu de passage. La modification de l’espace induit aussi une inégalité entre les structures, les plus petites d’entre elles ne peuvent souscrire à ces exigences et ne pourront rouvrir avant un certain temps. Le maillage territorial tissé depuis quarante ans prend un coup.
Le mouvement enfin. Lieux d’échange, de rencontre, d’activités, la bibliothèque redevient statique. Silencieuse. Les règles générales de protection des personnes dans les établissements recevant du public s’appliquent : port de masque, visières, hygiaphone et gestes barrières. L’inverse de ce que plaident les professionnels depuis plus de vingt ans : le rapprochement, la convivialité, le lien.
Ces mesures contraignantes de protection des publics et des personnels sont également onéreuses et l’acquisition du matériel de protection se fait au détriment des budgets, déjà serrés, consacrés aux acquisitions ou à la programmation d’activités culturelles. Les professionnels s’alertent de ces questions et craignent que les bibliothèques ne fassent encore les frais des arbitrages budgétaires qui ne manqueront pas de survenir dans la crise financière qui s’annonce.
Ces modifications posent questions. La fréquentation réduite des locaux et une diminution de l’activité des établissements apparaissent indispensables afin de garantir la sécurité des personnels et des publics en cette période de pandémie mais quid de la bibliothèque telle qu’on la connait ? Comment faire en sorte que tous les publics s’y retrouvent malgré un périmètre d’action amputé, notamment de son volet social ? En favorisant l’inclusion de certains publics, en permettant l’échange entre les personnes ou, bien sûr, en permettant l’accès à la culture, les bibliothèques sont bien plus qu’un simple guichet d’enregistrement. Premier service culturel de France, la diversité des activités traditionnellement proposées permet de créer du lien dans les territoires et contribue à tisser un réseau social dense. Service de proximité, parfois seul service public encore à disposition, l’attachement des publics à leur bibliothèque n’est plus à démontrer. Les personnels des bibliothèques vont d’ailleurs souvent bien au-delà de leur rôle de professionnel de l’information et s’investissent auprès des populations qu’ils desservent. Les bibliothèques ne sont pas un ERP comme les autres.
Une deuxième vague épidémique n’est pas annoncée dans l’immédiat. Ce temps de répit sera le temps de la reprise d’une activité progressive. Mais, à la suite de Dominique Lahary et Anne Verneuil, ce peut aussi être un temps pour repenser la bibliothèque, garder le bon et préparer le pire.
Adèle Sini, responsable éditorial
[1] Les collectivités territoriales restent frileuses. Elles engagent leur responsabilités pénale et administrative. Les articles L 310-1 du code du patrimoine et L 121-2 du code pénal en particulier stipulent ainsi que la responsabilité des tutelles peut être engagée en cas d’infraction commise par une bibliothèque ou d’une violation manifeste des conditions particulières de sécurité prévue par la loi. La responsabilité administrative des édiles peut également être invoquée pour les mêmes raisons, sous réserve cependant de prouver le lien de causalité entre la faute et la personne responsable
La lecture est un droit
Les droits fondamentaux des détenus, dont l’accès aux livres et à la lecture, sont réaffirmés avec force par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dans une liste de recommandations publiées au journal officiel le 4 juin 2020. Les bibliothèques de prison, ici évoquées au chapitre V, sont soumises à des contraintes spécifiques de temps et d’espace. Lieux d’éducation, d’information, de culture et d’échanges mais également lieux clos, difficilement accessibles et en prise avec de nombreuses difficultés humaines et économiques, ces bibliothèques sont des lieux à part. Les personnes qui les gèrent répondent avec plaisir à l’injonction qui leur est faite de faciliter l’instruction de leurs publics, d’aider ces populations caractérisées par un rapport compliqué à la lecture ou encore de favoriser les échanges et l’insertion.
La lecture est donc un droit fondamental non limité par une décision de justice et « chaque établissement [pénitentiaire] dispose d’une bibliothèque […] [1]». L’obligation de mise à disposition d’une bibliothèque est un cas unique en France et propre au milieu fermé. Rien n’impose, par exemple, aux élus de mettre à disposition de leurs administrés une structure de lecture publique. En prison, où la liberté d’aller et venir[2] est limitée, l’administration pénitentiaire se doit d’ « assurer le développement culturel[3] » par le biais de partenariats avec les bibliothèques municipales, les directions régionales d’action culturelle (DRAC) ou le Centre national du livre (CNL) notamment[4]. Les missions de ces bibliothèques si particulières sont, par ailleurs, clairement énoncées dans la circulaire du ministère de la Justice du 3 mai 2012 et dans le rapport n°9712 de 2006 de l’International federation of librarian association (IFLA). Elles doivent être : des lieux de lutte contre l’illettrisme, des lieux de formation et de professionnalisation, des lieux de ressource pour toutes les disciplines, des lieux d’information, de loisir et de socialisation. Chacune de ces six missions a pour objectif la réinsertion des personnes incarcérées. Chacune de ces six missions est entravée par les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les personnels travaillant dans ces structures : locaux exigus, accessibilité restreinte, manque chronique de moyens financiers et humains, etc.
Le peu de moyens alloués par l’administration pénitentiaire aux bibliothèques est un facteur majeur d’explication des difficultés de fonctionnement des bibliothèques de prison. La moyenne des budgets d’acquisition est d’environ 1000€ par an. Cette somme est nettement insuffisante pour mettre à disposition de collections fraiches, diversifiées et de qualité. La moyenne d’âge des collections, quasi exclusivement constituées grâce aux dons dans certains établissements, est comprise entre 5 et 10 ans. Le livre est souvent le seul support disponible alors même que d’autres média comme les supports audiovisuels seraient à privilégier en raison du fort taux d’illettrisme et du rapport compliqué que la majorité des détenus entretiennent avec la lecture. Dans ces conditions, il est très difficile de proposer une offre de qualité et en quantité suffisante. L’offre d’activités culturelles[5] est moins impactée par ce manque structurel et chronique de moyens dans la mesure où il est possible de faire appel à des financements publics ou privés. Contrairement aux acquisitions, les projets culturels de la bibliothèque peuvent être pris en compte dans le cadre de la programmation de l’établissement. Les DRAC peuvent participer au financement de ces actions, des financements européens peuvent être demandés et nombre de fondations peuvent être sollicitées[6].
Adèle Sini
[1] 6 Code de procédure pénale, art. D 441-2.
[2] Constitution du 4 octobre 1958, art. 66.
[3] Code de procédure pénale. Op. Cit.
[4] FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS DE BIBLIOTHEQUES. Les bibliothèques / médiathèques en établissements pénitentiaires, fiche technique 4, 3 ème édition, rapport n°97, 2006.
[5] Code de procédure pénale, art. D44-1 : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ».
[6] Cet article est extrait de : « Toute prison a sa fenêtre ». Bibliothèques de prison, islam et laïcité » dans Bibliothèques, religions, laïcité / sous la direction de Fabienne Henryot. Éditeur : Paris : Hémisphères : Maisonneuve & Larose, DL 2018. Description : 1 vol. (281 p.) : ill., cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm
La lecture est un droit
Les droits fondamentaux des détenus, dont l’accès aux livres et à la lecture, sont réaffirmés avec force par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, dans une liste de recommandations publiées au journal officiel le 4 juin 2020. Les bibliothèques de prison, ici évoquées au chapitre V, sont soumises à des contraintes spécifiques de temps et d’espace. Lieux d’éducation, d’information, de culture et d’échanges mais également lieux clos, difficilement accessibles et en prise avec de nombreuses difficultés humaines et économiques, ces bibliothèques sont des lieux à part. Les personnes qui les gèrent répondent avec plaisir à l’injonction qui leur est faite de faciliter l’instruction de leurs publics, d’aider ces populations caractérisées par un rapport compliqué à la lecture ou encore de favoriser les échanges et l’insertion.
La lecture est donc un droit fondamental non limité par une décision de justice et « chaque établissement [pénitentiaire] dispose d’une bibliothèque […] [1]». L’obligation de mise à disposition d’une bibliothèque est un cas unique en France et propre au milieu fermé. Rien n’impose, par exemple, aux élus de mettre à disposition de leurs administrés une structure de lecture publique. En prison, où la liberté d’aller et venir[2] est limitée, l’administration pénitentiaire se doit d’ « assurer le développement culturel[3] » par le biais de partenariats avec les bibliothèques municipales, les directions régionales d’action culturelle (DRAC) ou le Centre national du livre (CNL) notamment[4]. Les missions de ces bibliothèques si particulières sont, par ailleurs, clairement énoncées dans la circulaire du ministère de la Justice du 3 mai 2012 et dans le rapport n°9712 de 2006 de l’International federation of librarian association (IFLA). Elles doivent être : des lieux de lutte contre l’illettrisme, des lieux de formation et de professionnalisation, des lieux de ressource pour toutes les disciplines, des lieux d’information, de loisir et de socialisation. Chacune de ces six missions a pour objectif la réinsertion des personnes incarcérées. Chacune de ces six missions est entravée par les nombreuses difficultés auxquelles se heurtent les personnels travaillant dans ces structures : locaux exigus, accessibilité restreinte, manque chronique de moyens financiers et humains, etc.
Le peu de moyens alloués par l’administration pénitentiaire aux bibliothèques est un facteur majeur d’explication des difficultés de fonctionnement des bibliothèques de prison. La moyenne des budgets d’acquisition est d’environ 1000€ par an. Cette somme est nettement insuffisante pour mettre à disposition de collections fraiches, diversifiées et de qualité. La moyenne d’âge des collections, quasi exclusivement constituées grâce aux dons dans certains établissements, est comprise entre 5 et 10 ans. Le livre est souvent le seul support disponible alors même que d’autres média comme les supports audiovisuels seraient à privilégier en raison du fort taux d’illettrisme et du rapport compliqué que la majorité des détenus entretiennent avec la lecture. Dans ces conditions, il est très difficile de proposer une offre de qualité et en quantité suffisante. L’offre d’activités culturelles[5] est moins impactée par ce manque structurel et chronique de moyens dans la mesure où il est possible de faire appel à des financements publics ou privés. Contrairement aux acquisitions, les projets culturels de la bibliothèque peuvent être pris en compte dans le cadre de la programmation de l’établissement. Les DRAC peuvent participer au financement de ces actions, des financements européens peuvent être demandés et nombre de fondations peuvent être sollicitées[6].
Adèle Sini
[1] 6 Code de procédure pénale, art. D 441-2.
[2] Constitution du 4 octobre 1958, art. 66.
[3] Code de procédure pénale. Op. Cit.
[4] FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS DE BIBLIOTHEQUES. Les bibliothèques / médiathèques en établissements pénitentiaires, fiche technique 4, 3 ème édition, rapport n°97, 2006.
[5] Code de procédure pénale, art. D44-1 : « Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire ».
[6] Cet article est extrait de : « Toute prison a sa fenêtre ». Bibliothèques de prison, islam et laïcité » dans Bibliothèques, religions, laïcité / sous la direction de Fabienne Henryot. Éditeur : Paris : Hémisphères : Maisonneuve & Larose, DL 2018. Description : 1 vol. (281 p.) : ill., cartes, graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Le Patrimoine, il est là. Penser cet objet, c’est d’abord constater sa présence, se colleter avec cette évidence. Qu’il s’agisse des vieilles ruines d’un château fort perdues au milieu de la campagne ou de l’alignement des reliures dorées de livres anciens, cette matérialité en impose et nous oblige. C’est le sens que recouvre le mot dans les différentes langues d’Europe occidentale. Le français « patrimoine », hérité du latin patrimonium, et dont on retrouve les équivalents en italien, en espagnol, en portugais, désigne « les biens transmis par le père ». L’anglais heritage est encore plus explicite. Le mot allemand Erbe provient d’une racine signifiant « orphelin ». Si l’angle diffère, l’idée générale demeure. Le « patrimoine », ce sont des biens qui nous ont été légués par l’histoire. Peu importe qu’il s’agisse du magot convoité d’une riche famille, ou bien des pauvres effets d’une vieille tante morte sénile : en hériter nous en rend responsables. Du premier, sans doute, on saura s’accommoder. Des seconds, toutefois, il faudra aussi se préoccuper : régler la succession, payer les droits, vendre ou louer la maison, peut-être la rénover ou la détruire, prendre une décision, toujours. Qu’il nous réjouisse ou qu’il nous embarrasse, quelle que soit sa valeur, il nous faudra assumer cet héritage, en prendre la mesure, le gérer, fût-ce pour le détruire et faire de la place.
Pour parvenir jusqu’à nous, ce patrimoine aura connu bien des vicissitudes. L’histoire, dès lors qu’on la considère dans la durée, n’en est pas avare : conflits, révolutions, inondations, incendies n’épargnent guère les choses matérielles, vieilles pierres et vieux papiers. Pour ce qui concerne le patrimoine écrit, les flux et reflux de ces tempêtes conduisent rarement à constituer des collections homogènes et cohérentes. Ou plutôt si : ces collections ont ceci de cohérent d’avoir été bâties ainsi, et non autrement, d’exister ainsi. « Le réel est rationnel », dit Hegel, et il nous appartient de chercher la raison de cet entassement. Telles qu’elles sont, les collections témoignent d’une histoire, avant tout celle du territoire dans lequel elles ont été constituées. La géographie fait l’histoire et, en l’espèce, elle fait l’historiographie. C’est le rôle du responsable d’un fonds patrimonial de collationner cette histoire, jusque dans celle de chacun des documents qu’il conserve.
Face à ce patrimoine, nous sommes peu de chose : nous ne faisons que passer. Il était là avant nous, il sera là après. Il le sera, du moins, si nous lui donnons la chance de subsister, car, aussi modestes que nous restions devant lui (« Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent ! »), nous n’en sommes pas moins tout-puissants : nous avons la possibilité de le nier, de le détruire. L’actualité récente (Bâmiyân, Palmyre) ne nous l’a que trop montré. Des cas extrêmes ? Peut-être pas : il se pourrait bien que nous ayons à faire usage de cette toute-puissance. Si l’état du fonds témoigne de son histoire, nous ne faisons pas moins partie de cette histoire et rien ne nous interdit d’y apposer notre marque. Cette histoire est-elle source de cohérence ? Oui, mais cette cohérence est affaire d’interprétation, d’épistémè. « Notre histoire n’est pas notre code » : c’est aussi la responsabilité du bibliothécaire d’avoir la connaissance et l’intelligence de son fonds, de distinguer dans sa cohérence même l’essentiel de l’accessoire, d’assurer sa vie et sa pérennité en le débarrassant de ce qui l’encombre. En cela, le bibliothécaire patrimonial n’est pas différent de celui de lecture publique, il doit savoir, le moment venu, « désherber ». Bien sûr, il le fera avec discernement : on ne met pas à la benne des collections qui, pour inappropriées qu’elles soient dans ce fonds-là, n’en gardent pas moins une valeur, sinon patrimoniale, au moins sentimentale, ou, pour le dire autrement : pécuniaire. Ainsi, on prendra soin d’identifier les bibliothèques qui pourraient être intéressées par les collections « désherbées », les associations qui sauront en faire bon usage, les libraires qui seraient prêts à les acheter (à condition, bien sûr, que l’argent perçu bénéficie à l’entretien du fonds lui-même).
Fort de cette prise de pouvoir sur son fonds, le bibliothécaire pourra d’autant mieux assumer ses prérogatives : conserver, valoriser. C’est en quelque sorte un mariage de raison qu’il contracte avec sa collection, en osant un archaïsme, nous dirons : un « matrimoine », le mot, attesté en ancien français, désigne en latin (matrimonium) le mariage, comme il continue de le faire en italien (matrimonio). Ce paradoxe, « désherber » pour mieux conserver, n’en est un qu’en apparence, ou plutôt, il vient au service d’un autre paradoxe : montrer pour mieux conserver, ce que Florence Schreiber appelle « exposer », usant de la polysémie de ce verbe1. Montrer la collection, plus largement, l’exploiter, c’est lui donner une existence publique, la faire entrer dans un écosystème propre à la faire connaître, y compris des élus et des « décideurs », les seuls habilités à allouer un budget à sa conservation. C’est en montrant qu’on pourra mieux conserver, c’est en conservant qu’on pourra mieux et plus longtemps montrer.
Le métier de responsable d’un fonds patrimonial repose ainsi sur ces deux missions : conserver (un fonds qu’on pourra, au besoin, « désherber » ou enrichir), valoriser (auprès du grand public comme des chercheurs, ce qui suppose de l’avoir au préalable « signalé » dans un ou des catalogues)2. Cette double mission place la collection au cœur d’un réseau de relations qu’il convient d’expliciter.
Le premier public du fonds, ce sont ses bibliothécaires. Les responsables du fonds patrimonial ont pour devoir de connaître leur fonds, y compris par une démarche scientifique. Un travail de recherche permettra de connaître le contenu du fonds, mais plus encore sa provenance, l’histoire de sa constitution, ainsi que cela a déjà été dit plus haut. Ce travail aura l’avantage de permettre de mieux évaluer les besoins des chercheurs, autre public de destination du fonds. Au-delà des responsables eux-mêmes, la connaissance du fonds devra infuser dans le reste de l’équipe : le patrimoine n’est pas l’affaire des seuls collègues estampillés comme tels, il est un service qui peut enrichir l’ensemble des autres missions de la bibliothèque (par une visibilité dans les espaces accessibles au public, par des présentations thématiques dans le cadre des actions culturelles ou éducatives, par des propositions ad hoc pour les usagers plus éloignés des lieux de culture).
Les chercheurs, on l’a dit, sont un public naturel du fonds : encore faut-il ne pas se méprendre sur l’intérêt qu’ils peuvent y trouver. Des collections anciennes, parfois spectaculaires, qui captiveront les lecteurs de la bibliothèque, pourront n’avoir qu’un faible intérêt pour la recherche si elles ont été déjà largement défrichées, si elles sont présentes dans de nombreuses bibliothèques, si elles ont fait l’objet d’une numérisation. C’est encore une fois au responsable du fonds de savoir identifier quelles collections, par leur rareté ou leur unicité (ou parce qu’elles permettent de délester certaines collections nationales d’une partie de leur fréquentation), pourront intéresser les chercheurs. Le cas échéant, ce sont ces collections qui pourront faire l’objet en priorité d’une campagne de numérisation.
Si certaines collections ne présentent pas d’intérêt majeur pour la recherche, elles n’en demeurent pas moins des jalons possibles dans la formation des futurs chercheurs. Des ateliers d’initiation à la recherche historique à destination des lycéens et des étudiants de premier cycle pourront ainsi se révéler très profitables (qu’est-ce qu’une source ? comment la manipuler, la faire parler ? pourquoi confronter des sources ?). Plus largement, ce travail pourra être conduit avec tous les niveaux de classe, de la maternelle au lycée, chacun selon ses acquis et son programme. Ce travail, déjà largement pratiqué3, mérite d’être poursuivi.
Qu’en est-il des autres publics, ni universitaires ni scolaires ? La propriété des fonds patrimoniaux des bibliothèques est la plupart du temps nationale ou municipale (parfois intercommunale). En ce sens, il convient que ces fonds soient en quelque sorte « restitués » à leur propriétaire légitime : le peuple. Ils le sont à travers les formes classiques de l’exposition (pour Saint-Denis, citons : « Victor Hugo et son temps », « La santé à Saint-Denis au XIXe s. », « L’éducation sous la Commune », « 14-18 : hommes et femmes dans la guerre », etc.) et de la présentation orale (les différents avatars de « 10 minutes/1 œuvre »). Ils peuvent l’être encore sous de nouvelles formes, à inventer, dans lesquelles les réseaux sociaux trouveront aussi leur place. À cette fin, il paraît crucial de nouer des liens avec une constellation de partenaires : outre les élus et les grandes institutions nationales déjà mentionnés, les partenaires locaux, qui peuvent avoir une compétence sur le patrimoine (archives municipales, musées, monuments historiques, unités d’archéologie) ou bien offrir un accès à un public que la bibliothèque peinerait à aller chercher elle-même (associations de FLE – français langue étrangère, par exemple). De façon plus anecdotique, et selon les situations, les éditeurs (intéressés par des reproductions d’images ou de documents) ou les institutions étrangères (imaginons une bibliothèque disposant de fonds comparables dans un autre pays) pourront également être sollicités. D’autres formes de collaboration peuvent encore être imaginées : le recrutement de stagiaires, voire de jeunes en service civique, sur des fiches de mission rédigées à cet effet, le recours à du mécénat, voire à sa forme numérique de crowdfunding pour financer certaines opérations particulières (exemple de la restauration d’ouvrages). Certaines bibliothèques n’hésitent pas à tarifer leurs opérations de reproduction, notamment lorsqu’elles sont effectuées à des fins lucratives (publications).
Une fois que le bibliothécaire a pris ses responsabilités par rapport au fonds qui lui est échu – le circonscrire, lui donner une plus grande cohérence, prendre les mesures de conservation qui s’imposent pour les documents qui le nécessitent, cataloguer et signaler la collection –, il lui revient de se poser enfin la question qu’il n’a que trop différée : à quoi bon tout ça, et que faire de ce fatras ? Bien sûr, il ne fait aucun doute qu’il y a là un matériau de base pour le travail de l’historien, si celui-ci veut bien s’en emparer. Cette réserve n’est pas négligeable à l’heure où, pour les études historiques, « tout fait ventre » : les apports de l’archéologie, la documentation déjà largement accessible en ligne, l’étude des œuvres d’art, celle des archives et de tout ce qui peut se trouver ailleurs que dans les bibliothèques. Si l’historien a recours à nous, ce ne sera jamais que pour une faible part de nos fonds. Faut-il détruire le reste ? La question a déjà été abordée, et notre responsabilité de conserver excède ce qui est immédiatement utile. Pour l’éternité, à ce jour, le support imprimé reste plus fiable et plus durable que d’incertains et versatiles formats numériques. À quoi bon tout ça ? La réponse appartient une nouvelle fois au propriétaire légitime des fonds, le citoyen, c’est lui qui dictera au bibliothécaire la conduite à suivre.
La société contemporaine est habitée par une inquiétude, celle de l’insignifiance. Tout passe, tout va trop vite. Le monde du travail soumet parfois le salarié à des rythmes effrénés, à des tâches tellement segmentées qu’elles en deviennent incompréhensibles : le travailleur ne voit plus « la cathédrale qu’il habite ». Des flux financiers largement virtuels commandent aux forces productives. Les inégalités se creusent, le lien social se délite. Dans les grands échanges mondiaux, les identités se confrontent et s’exacerbent, de peur de se dissoudre. La planète elle-même, sapée par une exploitation incontrôlée de ses ressources, ne semble plus un terrain sûr sur lequel poser les pieds. Dans la turbulence des flots, chacun cherche où jeter son ancre. Il n’y va pas que de la quête controversée d’une insaisissable « identité nationale ». Le « petit blanc » se raccroche à la nation comme certains enfants de l’immigration en déshérence se raccrochent à leur religion : ce ne sont à chaque fois que des caricatures de cette nation et de cette religion, coupées de toute construction historique4. Des communautés se créent sur les réseaux sociaux entre personnes qu’un même goût, un même centre d’intérêt, une même préférence rapprochent. Qui suis-je ? Le « né sous X » veut connaître sa mère, le citadin creuse ses généalogies rurales, l’employé déboussolé retourne à la terre. Dans une époque de plus en plus horizontale, on cherche un peu de verticalité, pour le dire avec un vieux mot, de racines.
Nos collections patrimoniales sont comme la vie : elles sont profuses, désordonnées (malgré nos efforts !), protéiformes. C’est bien le diable si quiconque n’y trouve quelque chose à quoi se raccrocher, un signe de reconnaissance. Faut-il se limiter à ce signe ? Non, bien sûr, mais c’est une clé d’entrée. On vient chercher dans les collections patrimoniales quelque chose qui puisse nous parler, on y trouve tout autre chose, un fil qu’on n’en finit plus de tirer. Tout responsable d’un tel fonds en a fait l’expérience, il convient de la partager avec le public. Nos fonds témoignent pour l’histoire, y compris par leurs lacunes, ils permettent à chacun de trouver une place, de se situer, à une condition qui est aussi, pour nous, une exigence : utiliser ces fonds pour montrer que nulle histoire ne saurait être univoque. Il y a une vérité des faits bien sûr, il y a aussi une pluralité d’approches pour les interpréter. Il ne s’agit pas pour nous de dire : « ça s’est passé ainsi », encore moins, bien sûr, de délivrer une interprétation idéologique de l’histoire, mais bien, à partir des connaissances et des attentes mêmes du public, de lui faire partager la complexité du réel. Et l’histoire ne cesse de s’imbriquer en elle-même, de se mettre en abyme. Il y a ainsi, par exemple, une histoire de la Commune de Paris – l’un des domaines d’excellence des fonds de Saint-Denis –, il y a aussi une histoire de la réception de cet événement, une « histoire de son histoire », et on n’en parle pas de la même façon en 1872 qu’en 1936, non plus qu’entre un journal d’opinion ou une brochure scientifique, un périodique conservateur ou socialiste. Embarquons l’usager dans cette aventure : nous ne sommes pas des professeurs d’histoire, nous sommes détenteurs de sources qui ne disent pas la même chose, qui se contredisent, qui occultent des propos ou des événements, les enjolivent ou les déforment. Parti pour retrouver une trace de soi (encore faut-il que la bibliothèque ait consigné une telle trace, mais je parlerai de cela plus loin), le lecteur se retrouve un parmi d’autres, dans le kaléidoscope des points de vue, des identités et des mémoires.
Par sa nature, le patrimoine écrit témoigne de l’Histoire à un triple niveau. En tant qu’objet matériel, le livre s’inscrit dans l’histoire des supports de l’écrit, l’histoire des médias et, au-delà, celle des modes de production. Il y a beaucoup à dire sur l’objet lui-même, sa période de fabrication, sa facture, ses commanditaires, son imprimeur, avant même d’en avoir déchiffré le contenu. Bien sûr, ce contenu, texte ou images, vaut également pour lui-même, pour ce qu’il dit, et pour la façon dont il s’insère dans une épistémologie : histoire de la connaissance en général, ou d’une discipline en particulier. Entre les deux, matérialité de l’objet et intellectualité de son contenu, l’établissement du texte, son caractère original ou bien sa conformité à un original, ses variantes, la façon dont il a été édité, enrichi, coupé ou censuré, composé enfin sur la page, renseigne sur le statut de ce texte dans l’époque où il a été imprimé. Chacun de ces niveaux d’analyse ouvre à des formes de valorisation diverses.
En tant que tel, le document peut être exposé, ou bien faire l’objet d’une présentation orale, cela a été dit. Il peut également être pris en photo pour figurer sur des supports imprimés ou numériques. Ce sont ces déclinaisons qui seront le plus à même de toucher le grand public, voire les personnes les plus éloignées des lieux de culture. Le contenu, selon sa difficulté (langue d’écriture, lisibilité) pourra n’être accessible qu’à des spécialistes : c’est le règne du chercheur. Rien n’interdit, toutefois, pour des documents récents, accessibles, à fort caractère visuel (unes de presse par exemple) d’y travailler avec des groupes scolaires ou universitaires, dans des ateliers de sensibilisation à la méthode de l’historien. Dans une époque qui pose de façon prégnante la question de la fiabilité des sources (problème des fake news et de leur diffusion via les réseaux sociaux), on peut imaginer de confronter des élèves au traitement différencié d’un même événement (si possible de leur programme d’histoire) par différents journaux, et à les faire s’interroger sur ces différences. Pour ce qui est de l’établissement du texte, s’il relève aussi de la sphère du chercheur, il peut également nourrir une réflexion du même type sur la fiabilité des sources. Il renseigne également, sous l’aspect de la composition de la page, sur l’histoire du livre. Ce sont ces deux derniers aspects, analyse du contenu et de sa mise en forme qui profiteront le plus d’une campagne de numérisation.
Travailler sur des vieux papiers n’interdit pas de le faire de façon innovante. Les problématiques très contemporaines de l’accueil, des services aux publics « éloignés » ou « empêchés », de la participation et de la « co-construction » peuvent également nourrir la réflexion sur l’exploitation des fonds patrimoniaux. Côté accueil, on veillera à ce que les usagers qui expriment une curiosité pour ces fonds, du professeur d’université au jeune élève, en passant par l’étudiant de troisième cycle, l’érudit local, le retraité, le généalogiste, soient traités non seulement, bien sûr, avec les mêmes égards, mais aussi à travers une approche adaptée. On ne toisera pas le néophyte du haut de ses connaissances patrimoniales, pas plus qu’on ne demandera au professeur de ne pas écrire sur les livres. Surtout, pour chacun d’entre eux, on s’appuiera sur ses attentes, ses connaissances, ses intérêts, et on commencera par le faire parler de ce qu’il voit dans le document. On se gardera ensuite de lui asséner le discours du « sachant », mais on mettra au contraire en doute son propre savoir, tant il est vrai que la connaissance historique peut à chaque instant être remise en cause. On ne tombera pas pour autant dans le relativisme du « on ne sait pas grand-chose ». La valorisation pourra même se faire participative : pourquoi ne pas construire un chemin d’exposition avec les usagers eux-mêmes, sur le modèle du Biblio Remix, par exemple avec une classe de lycée ou des étudiants de premier cycle ? Le prêt d’ouvrage patrimoniaux, expérimenté notamment à la BHVP (Bibliothèque historique de la Ville de Paris), pourrait constituer une autre façon de rapprocher le public de ces collections. La trace des femmes au sein de notre héritage patrimonial, préoccupation récemment apparue sous la forme d’une nouvelle acception de « matrimoine », devra être recherchée. Enfin, rien n’empêche, même, voire surtout, longtemps après, de revenir vers ses usagers pour s’interroger sur ce à quoi notre action a servi : monter avec des classes des projets ambitieux associant ateliers créatifs, présentation des collections, visites d’expositions ou de la BnF ? A-t-on demandé à un sociologue, dix ans après, d’enquêter sur ce que ces élèves sont devenus, ce qui s’est déposé en eux, jeunes gens, de ces vieux sédiments ?
Le patrimoine ne meurt pas avec nous. L’actualité éditoriale d’aujourd’hui fera les collections patrimoniales de demain. Pour autant, les bibliothèques territoriales ne partagent pas la mission de conservation exhaustive de la bibliothèque nationale. Dans ces conditions, que conserver ? Les fonds, tels qu’ils existent, en sont une indication. Il faut continuer d’enrichir ce que j’ai appelé les « domaines d’excellence » : par des acquisitions rétrospectives chez les libraires ou en salle de vente si on le peut, par le suivi de l’actualité éditoriale au minimum. Le désherbage des collections de lecture publique fournira également un appoint. Parfois, s’il témoigne d’orientations nouvelles dans la vie des fonds, il pourra faire l’objet de la création d’un nouveau « domaine d’excellence ». Les travaux de recherche réalisés à partir des fonds devront également être conservés en tant que tels. Ces différents accroissements ne devraient pas faire l’impasse sur la conservation numérique des sites Internet en relation avec les fonds, au moins pour la partie du fonds local.
Est-ce suffisant ? On l’a dit, nos fonds tiennent le peu de cohérence qu’ils peuvent avoir de leur fidélité à l’histoire, à la géographie, à la sociologie d’un territoire. Cette sociologie évolue-t-elle ? Comment nos fonds en rendront-ils compte ? Les dons et legs peuvent y pourvoir. Parfois, il peut se révéler utile de les précéder, de les susciter. Dans une banlieue populaire comme Saint-Denis, l’histoire du mouvement ouvrier est un domaine d’excellence car Saint-Denis a longtemps été une ville ouvrière. Elle ne l’est plus. Elle est en revanche devenue une ville multiculturelle qui s’enorgueillit d’accueillir plus de 100 nationalités. Ce pourrait être aussi une donnée à prendre en compte dans la constitution des fonds patrimoniaux, par exemple par la construction d’une « bibliothèque des diasporas » encore à imaginer. Ainsi les collections épouseraient-elles le continuum de l’histoire, ainsi l’usager se voyant reconnu dans ce continuum aurait-il d’autant plus de curiosité pour ce qui l’a précédé, ainsi se sentirait-il accepté dans cette histoire. À ce prix, notre « matrimoine de raison » pourrait-il donner naissance à de beaux enfants.
1. J’emprunte cette idée à l’article « Exposer le patrimoine » de Florence Schreiber, publié dans L’action culturelle en bibliothèque, sous la direction de Bernard Huchet et Emmanuèle Payen, Éditions du Cercle de la Librairie, 2008.
2. Je reprends là les quatre grandes catégories dressées par le Manuel du patrimoine en bibliothèque, sous la direction de Raphaële Mouren, Éditions du Cercle de la Librairie, 2007.
3. En témoigne le partenariat entre le réseau de lecture publique de Plaine Commune et la BnF : outre l’article de Florence Schreiber déjà cité, on pourra consulter, de la même, « Quelque chose de Saint-Denis… », publié dans Bibliothèque(s), revue de l’Association des bibliothécaires de France, en juin 2006 (n° 26/27).
4. J’emprunte cette idée à l’ouvrage d’Olivier Roy, La sainte ignorance, éd. du Seuil, 2008.
La technologie numérique a bouleversé la méthodologie de la recherche documentaire et facilité l’accès aux textes. Nous attestons ici des difficultés auxquelles sont confrontés les étudiants de master, dans le cadre de leurs recherches documentaires, liées à la rédaction de leur mémoire. Ils rencontrent des difficultés majeures dans deux domaines. Ils perdent les repères spatiaux. Le système d’organisation des connaissances des bases de données génère une déroute. Par ailleurs, ils peinent à comprendre et utiliser les langages documentaires spécifiques à chacun des outils consultés.
De plus en plus de maquettes de diplômes universitaires intègrent des formations à la recherche documentaire. La complexité des modalités d’interrogation et la variété des ressources documentaires existantes donnent le tournis aux étudiants. Les personnels des bibliothèques qui travaillent régulièrement avec ces outils ont intégré, au fil de l’eau, leurs évolutions. Mesure-t-on les difficultés que rencontrent les usagers lorsqu’ils utilisent ces ressources ? Le numérique permet d’accéder à une quantité impressionnante de références et documents. Les étudiants doivent trouver puis sélectionner les documents les plus pertinents pour leurs recherches. Pour cela, il leur faut dompter les modalités d’interrogation des ressources numériques. Ils les découvrent souvent brutalement et expriment leur désarroi, voire leur sidération. À l’issue de plusieurs centaines d’heures consacrées à la formation à la méthodologie de la recherche, conduites en M1 et M2 du master des métiers de l’enseignement du premier degré de l’université de Strasbourg, nous souhaitons ici analyser les difficultés rencontrées. « Les détails des avantages et inconvénients rencontrés dans la pratique de la documentation électronique sont édifiants » [Lambert, 2013, p. 54], constate également Vincent Lambert dans le cadre d’une étude comparable conduite à l’université de Nice.
Le support numérique ne facilite pas tout, tentons d’en comprendre les raisons. Comment se redéfinit le rapport au travail dans les environnements organisationnels en prise avec le numérique [Bidet et al., 2017] ? Comment, à cette aune, se redessinent métiers et compétences, par exemple entre compétences techniques et communicationnelles [Bouillon, 2015] ? En quoi le digital labor [Cardon et Casili, 2015], en révélant tout particulièrement la porosité des frontières organisationnelles, modifie-t-il la vision classique de la répartition des tâches et compétences ? Après avoir présenté la méthodologie de l’étude, nous allons voir en quoi la question du support, de l’espace, du langage documentaire et des masques de recherche complexifie la démarche de recherche documentaire.
En master 1 des métiers de l’enseignement et de la formation du premier degré, la maquette de l’ÉSPÉ (école supérieure du professorat et de l’éducation)1 de Strasbourg prévoit six heures de travaux pratiques de formation à la recherche documentaire réparties en trois séances. Le cours s’intitule « Méthodologie de la recherche documentaire ». En master 2, quatre heures de travaux pratiques sont consacrées à une « Initiation à la recherche – projet de mémoire ». Ces cours s’effectuent en présentiel et sont co-animés par un maître de conférences en sciences de l’information et un membre de l’équipe de la bibliothèque de leur site de formation. Les membres du service des bibliothèques universitaires détiennent un label formateur validé par l’Enssib.
Cette co-animation peut surprendre mais elle nous paraît essentielle. Le maître de conférences cerne les attendus du mémoire, garantit la valeur scientifique des documents moissonnés, élabore la démarche didactique employée, ajuste, si nécessaire, les problématiques retenues par les étudiants. Les personnels des bibliothèques qui dépouillent les documents, cataloguent, nourrissent le portail documentaire et les bases de données, sont les plus au fait des évolutions techniques des différentes ressources. Ce sont eux qui présentent les modalités d’interrogation des différents espaces. Ils prennent également le relais, une fois la formation terminée, pour retrouver, si nécessaire ,les étudiants dans le cadre d’un entretien individuel. Ce partenariat répond aux préconisations du rapport réalisé par le LISEC (Laboratoire interuniversitaire de sciences de l’éducation et de la communication) : L’articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services de documentation au cœur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur (2016). Cet enseignement est facultatif en M1, mais obligatoire en M2. Les cours sont planifiés entre les mois de septembre et de décembre. L’objectif en première année vise à présenter les modalités d’interrogation du portail documentaire de l’université et à faire découvrir le fonds documentaire spécifique à l’ÉSPÉ. En deuxième année, les étudiants doivent rédiger et soutenir un mémoire de recherche. Ils ont donc nécessairement besoin de procéder à des recherches documentaires pointues.
Un recul de plusieurs années de pratique a permis à l’équipe des formateurs d’améliorer tant la progression que les activités proposées. Les éléments développés ci-dessous résultent, d’une part, d’une analyse des retours informels entre les formés et les formateurs. Nous avons noté leurs questions et relevé ce qui leur posait problème dans leurs démarches de recherche documentaire. D’autre part, nous avons soumis en 2018, l’ensemble d’une promotion de 200 étudiants de master 2, à une enquête de satisfaction.
La formation s’adresse à un public extrêmement hétérogène, issu de cursus forts divers. Les étudiants ont rarement bénéficié d’une formation méthodologique et, lorsque c’est le cas, ils ont travaillé sur des bases de données en lien avec la discipline suivie en licence. Très souvent, les professeurs leur ont alors fourni des bibliographies. Il leur fallait « simplement » interroger le catalogue, localiser le document (une cote pour un livre, le nom de la revue pour un article) pour accéder au texte. Certains parmi eux ont suivi une formation professionnelle et n’ont que peu utilisé les outils documentaires. Les étudiants que nous avons accueillis en formation sont tenus de rédiger un mémoire de recherche et non un mémoire professionnel pour valider leur master. Ils se trouvent, de ce fait, contraints d’utiliser les outils documentaires. Où chercher ? Comment chercher ? Que chercher ? L’espace qui s’offre à eux s’avère abyssal, opaque et même anxiogène. Ils déclarent être perdus. Nous notons des cas extrêmes de crise de larmes, d’autres à l’inverse rient, lâchent leur clavier et appellent à l’aide.
– Rien n’a été publié sur mon sujet ! affirme le stagiaire.
– Vraiment ? s’étonne le formateur.
Quelques clics plus loin, la démonstration est faite. Le stagiaire avait mal interrogé les espaces documentaires.
La situation inverse existe aussi, le stagiaire est submergé de résultats mais ne maîtrise pas les techniques de tris.
Comment expliquer ces réactions ?
Toutes les informations se lisant sur écran, les étudiants perdent les repères physiques qu’autorise le support papier. Claire Belisle (2011) pointe la nécessité pour un être humain de dissocier la forme et le contenu d’un document. Le numérique complexifie cette opération en dématérialisant les supports. Lorsque l’on a matériellement dans les mains un livre, dont un chapitre correspond à l’objet d’étude, sa nature est évidente. Il sera référencé comme étant un « chapitre de livre ». De même, si l’on a matériellement sous les yeux une revue, il est simple de référencer le texte retenu comme un « article de revue ». Ce sont les normes de référencement bibliographique qui imposent cette identification du support. Dans le cas du chapitre du livre, c’est le titre du chapitre qui apparaîtra en italique. Dans le cas d’un article, c’est le nom de la revue qui sera en italique. Ces repères matériels disparaissent avec le numérique. Malgré le niveau d’études des stagiaires (bac + 3), la première notion à poser vise à consolider ce prérequis, à savoir la capacité à identifier la nature du texte qui s’affiche à l’écran. « Le patchwork informationnel des pages du web, de certains manuels scolaires ou magazines, disperse l’attention du lecteur (les psychologues parlent d’attention partagée), rendant la compréhension et la mémorisation plus difficiles » [Baccino, 2011, p. 63].
Nous émettons l’hypothèse que c’est, entre autres, la dématérialisation des supports qui génère un sentiment de perte.
– Où suis-je ?
– Pourquoi je n’accède pas directement au texte du document trouvé ?
– Comment faire pour lire le texte dont j’ai trouvé la référence ?
Ces questions révèlent la déroute des stagiaires. Ils n’arrivent pas à identifier tant l’espace que la fonction des outils qu’ils utilisent. Tout se ressemble, tout se lit sur écran. Lorsque nous accompagnons les étudiants dans leurs recherches, notre aide consiste également à les amener à reconnaître l’outil qu’ils utilisent. Est-ce un OPAC (Online Public Access Catalog) ? Est-ce un portail d’information ? Est-ce un site ? Est-ce une base de données ?
Notre objectif vise à les conduire à identifier puis à catégoriser les espaces documentaires consultés. Pour cela, nous commençons par présenter le portail documentaire de l’université, puis l’OPAC de l’université et ses modalités d’interrogation. Rien que la présentation de ces deux outils, portail et OPAC, montre que la perception de leurs fonctions n’est pas claire. Quels types de résultats vais-je obtenir en interrogeant tel ou tel espace ? Une cote ? Une référence d’article ? Un article en plein texte ? Pour clarifier cela, nous utilisons la métaphore d’un parc clos. On y pénètre par le biais d’un portail en montrant patte blanche : l’identifiant et le mot de passe. Ce parc se subdivise en plusieurs espaces aux fonctions différentes : la roseraie, le verger, le parc de jeux, le jardin japonais, le potager… Le langage utilisé par les professionnels des bibliothèques s’apparente au registre lexical de la botanique. On parle, par exemple, de désherbage lorsque l’on retire des rayons des documents estimés périmés. On récolte des notices à l’issue d’une recherche.
Les usagers doivent intégrer le fait qu’en fonction de l’outil utilisé, on récolte des références qui nécessitent un rebond. C’est le cas des catalogues. Dans d’autres situations, l’on accède directement au texte intégral, c’est le cas de la documentation électronique. La première notion à établir repose sur la nuance existante entre les catalogues, qui donnent des références, et les bases de données, qui conduisent directement au texte. Mais la performance des OPAC impose de relativiser cette affirmation. Aujourd’hui, ils dépassent la fonction de référencement. Ils permettent aussi un accès direct aux documents. Cette limite poreuse entre l’OPAC et l’accès aux textes intégraux, qu’autorise le support numérique, embrouille l’usager.
La localisation du document source, dans les environnements organisationnels documentaires en prise avec le numérique, n’est lisible que par un public averti, voire expert. De nouvelles compétences sont nécessaires aux usagers. Il s’agit pour eux de connaître et d’identifier les fonctions des différentes bases documentaires. Il leur est aussi impératif de maîtriser leur organisation, de percevoir comment elles s’imbriquent les unes dans les autres.
Prenons l’exemple d’une recherche portant sur la fluence d’une lecture à voix haute dans le contexte de l’enseignement primaire. L’usager va interroger le portail documentaire de l’université qu’il fréquente, en indiquant quelques mots clés dans le masque de recherches :
– Fluence
– « Lecture à voix haute »
– « École primaire »
Il utilisera des filtres pour restreindre les résultats sur des critères temporels (année de publication), de types de support (livre, document audiovisuel…). Il sélectionnera le ou les centres documentaires où porte sa requête, les portails documentaires fédérant les ressources de toute l’université. Le résultat de la requête lui permettra d’accéder à des notices, puis aux documents. En termes de catalogue, il faudra encore consulter le Sudoc. L’accès à des articles de périodiques ou à des livres numérisés portant sur le sujet nécessitera autant de requêtes que de bases interrogées. Pour notre sujet, il serait judicieux de consulter Cairn, mais aussi ERIC et/ou Persée. L’usager gagnera aussi à interroger les bases de données DUMAS et Thèses-Uonistra qui archivent les mémoires et thèses. Ce qui perturbe particulièrement les étudiants repose sur le fait que le dépouillement des périodiques n’est pas réalisé systématiquement dans les OPAC. La nécessité de jongler d’un outil vers l’autre requiert de la dextérité et surtout une prise de conscience de l’organisation générale de ce panorama documentaire. Une cartographie de ces espaces est difficile à dessiner dans la mesure où les frontières sont difficiles à placer, tant elles sont poreuses. Le portail documentaire aiguille vers des bases de données et des OPAC qui s’imbriquent les uns dans les autres. Il fournit aussi une possibilité d’une recherche fédérée. En utilisant cet outil, qui moissonne dans tous les espaces documentaires, la perte de repères est complète. C’est là que l’organisation des connaissances explose. Les frontières volent.
Dans le cadre de notre cours, nous avons retenu deux bases de données : Cairn et Europresse. Nous travaillons également les modalités d’interrogation de deux catalogues : le Sudoc et Callimaque. Nous présentons les sites internet Éduthèque et Éduscol. Pour finir, nous travaillons avec Google Scholar. Moteurs de recherche, OPAC, bases en ligne, sites… très vite, tout s’entremêle. Si les frontières flottantes entre ces différents espaces ne posent pas questions aux professionnels de la documentation, les étudiants s’y perdent.
À cette compétence d’identification de l’outil que l’on utilise s’ajoute celle de l’identification de la nature du document trouvé. S’agit-il d’un texte numérisé ? D’un texte numérique ? Notre rôle consiste à nouveau à donner des repères : après avoir identifié l’espace interrogé, il s’agit de faire apparaître les différences entre un texte numérisé et un texte numérique. Nous établissons qu’un texte numérisé a tout d’abord été publié sur un support papier, puis a été rendu lisible sur écran, par le biais d’une numérisation. Le texte numérique, quant à lui, n’a pas connu cette mutation de support. Il a exclusivement été publié sur écran. En prenant l’exemple de textes patrimoniaux, publiés sur le site Gallica par exemple, ce changement de support se clarifie. Nous posons ainsi une compétence supplémentaire. « Une ergonomie de la lecture est donc à développer » [Baccino, 2011, p. 66], indique Thierry Baccino dans une étude portant sur la lecture sur internet.
Avec le numérique, « beaucoup de chemins mènent à Rome ». Les OPAC, portails, bases en ligne assurent chacun des fonctions différentes et la richesse de leurs arborescences ne permet plus d’énoncer des généralités. Tout doit être nuancé. On peut arriver aux mêmes résultats en ayant recours à des procédures différentes. La sérendipité, les tâtonnements sur le web, avec notamment Google Scholar, obligent à la souplesse dans les démonstrations.
Hélène Fournier (2007) travaille avec un public similaire au nôtre, mais au Canada. Elle analyse les stratégies de recherches des professeurs en formation. Elle montre « certaines lacunes […] pour choisir des outils de recherche ou des descripteurs adaptés, pour limiter les résultats de recherche ». Françoise Chapron (2015), Annette Béguin, Stéphane Chaudiron et Éric Delamotte (2007) poursuivent, depuis les années 1990, une réflexion sur la nécessité de former à la culture informationnelle. Ils s’appuient sur une spécificité française : les centres de documentation et d’information que pilotent les professeurs documentalistes dans les établissements du second degré. Ces professionnels y développent une formation à la culture informationnelle. Yolande Maury, Susan Kovacs et Sylvie Condette (2018), Françoise Chapron (2015) pour le second degré, et Sophie Kennel (2014) pour le niveau supérieur ont bâti un curriculum, portant notamment sur des compétences visant à travailler les langages documentaires. Nous avons constaté que, malgré ces dispositifs de formation, les difficultés des étudiants perdurent à leur arrivée en master. Partir de leur objet de recherche et le traduire en concepts pertinents leur permettant d’interroger les moteurs de recherche ou les OPAC est assurément l’exercice qui leur est le plus difficile. Ils tentent systématiquement une recherche intuitive, en langage naturel, comme ils la pratiquent sur le web. L’absence ou l’incohérence des résultats obtenus les stupéfait. Par exemple, lorsqu’ils utilisent le descripteur « primaire », pour eux il s’agit d’un niveau scolaire. Les résultats de leur recherche portant sur l’ère primaire les étonnent. Ils n’hésitent pas à utiliser l’abréviation C2, lorsqu’ils enseignent au cycle 2 ou encore GS, pour grande section de maternelle. Évidemment, avec de tels mots clés, la recherche n’aboutit pas. Dans le même ordre d’idée, « maternelle » figure pour eux l’école maternelle. Ils comprennent au fur et à mesure de leurs errances qu’il leur est impératif d’être précis et qu’il leur est indispensable d’utiliser les concepts reconnus par les bases de données. À force de voir leurs équations ne pas aboutir ou fournir des résultats insatisfaisants, ils comprennent qu’ils doivent, en plus, modifier leurs mots clés selon la base utilisée, chacune d’entre elles nécessitant des modalités d’interrogation différentes. « Le travail sur l’information et la connaissance nécessite une expertise spécifique. Catégories, taxonomie, classification, modèles, tous doivent être maîtrisés pour chercher de l’information » [Belisle, 2011, p. 153]. Il leur faut donc accepter que chaque espace documentaire réagit différemment, même si l’on utilise des mots clés identiques.
À cette réalité s’ajoute celle de l’ergonomie des masques de recherche. Comparons trois d’entre eux.

Figure 1. Masque OPAC Unistra
Pour interroger l’OPAC de l’Unistra, un choix entre les quatre onglets proposés est impératif : Catalogue, Revues, Bases en ligne, Articles et +. Ce choix déstabilise pour de nombreuses raisons. L’onglet « Revues » permet une recherche à partir du nom de la revue. L’usager pourra ainsi savoir si la bibliothèque dispose de la collection Revue française de pédagogie par exemple. Souvent l’étudiant le sélectionne pensant qu’il va ainsi pouvoir effectuer une recherche thématique portant uniquement sur des articles de revues. Il n’en est rien. L’onglet « Bases en ligne » permet d’être aiguillé vers les bases auxquelles la bibliothèque est abonnée, Cairn par exemple. Celle-ci fournit, entre autres, des articles de revues. L’onglet « Articles et + », génère une recherche fédérée… qui moissonne bien évidemment aussi des articles de revues. Enfin, les bibliothécaires dépouillent des revues et les notices apparaissent lorsque l’on interroge le « Catalogue ». Ce simple exemple explique le malaise vécu par les étudiants. Ils n’y comprennent rien et s’en remettent souvent au hasard et aux tâtonnements.
Il leur faut aussi comprendre que les notices du catalogue de leur université sont déversées dans le catalogue commun à toutes les universités, le Sudoc Le Sudoc fonctionne comme une matriochka.
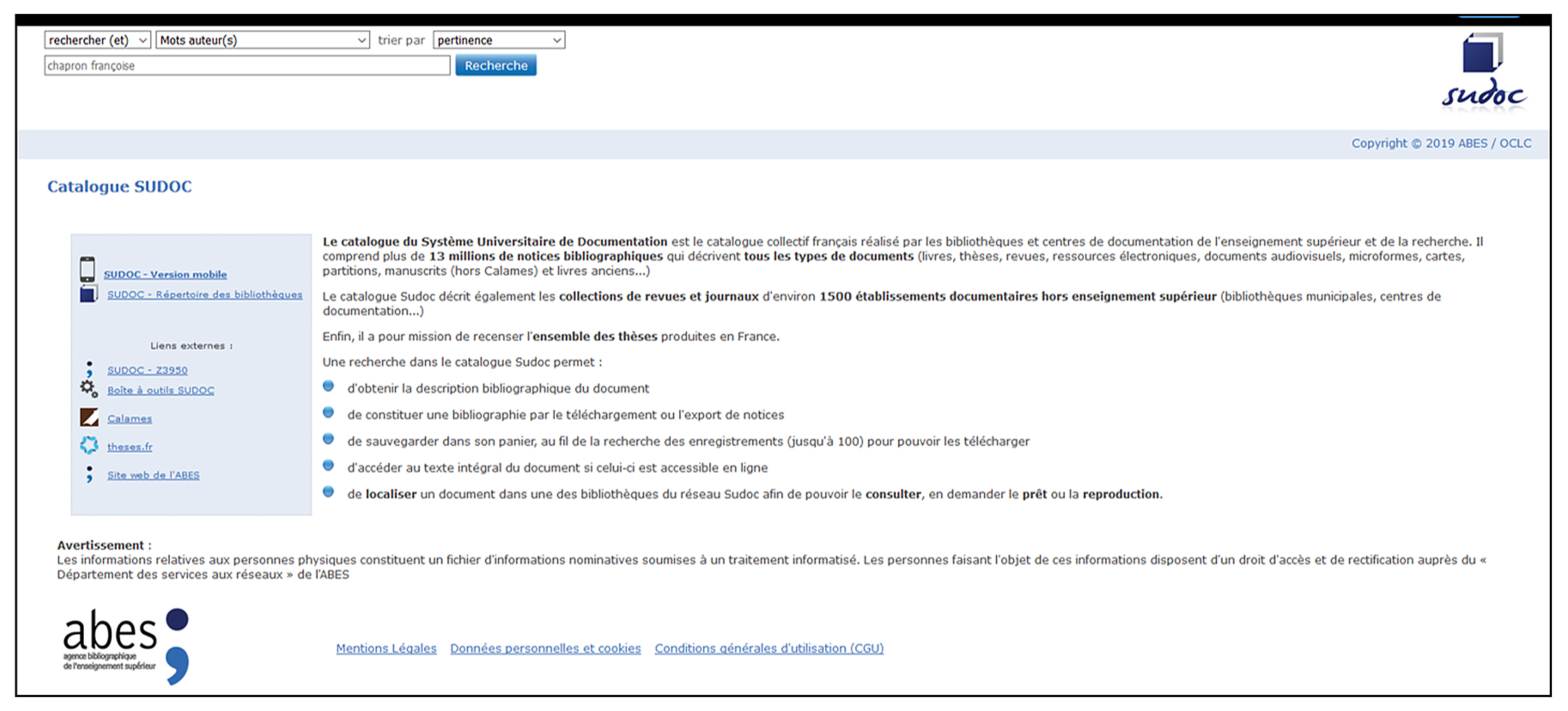
Figure 2. Masque OPAC Sudoc
Dans le cas du Sudoc, le masque à remplir est réduit. Il apparaît tout en haut de la page. Il fait assurément figure de l’OPAC le plus simple à utiliser, mais ce n’est qu’une apparence. La difficulté rencontrée repose sur l’indexation des documents. Les millions de notices compilées imposent, de la part de l’étudiant, une dextérité certaine. Il faut arriver à tricoter les différents critères de recherche possibles, sinon la noyade est assurée.

Figure 3. Masque OPAC Callimaque
Cette difficulté de rédaction d’équations documentaires se retrouve lorsque les stagiaires utilisent la base Callimaque du réseau Canopé. Elle fournit une option de recherche par critères, par thésaurus, avec ou sans OTAREN (Outil thématique d’aide à la recherche pour l’Éducation nationale). Et là, les esprits s’échauffent à nouveau. Ces notions s’avèrent quasiment inconnues.
L’apprentissage à la manipulation des outils de recherche documentaire est souvent laborieux. « La documentarisation externe, en particulier l’explicitation du contexte dans lequel le document a été produit et la recherche de systèmes d’organisation des connaissances en mesure d’orienter les lecteurs est au cœur de ces rôles et de leur [les bibliothécaires] compétence » [Zacklad, 2019].
Il est d’usage de saluer les apports du numérique. En recherche documentaire, l’efficacité des outils disponibles semble établie. Pourtant, les usagers ne mesurent pas à quel point il est essentiel d’apprendre à s’en servir, sous peine d’aboutir à des résultats de recherches infructueux. Souvent l’on récolte trop ou pas assez de références, voire des résultats trop éloignés du sujet. En méthodologie de formation à la recherche d’informations, on gagne à accompagner les étudiants en travaillant la notion d’espace. Il s’agit de les conduire à identifier les lieux qu’ils visitent. L’étape suivante consiste à faire prendre conscience que chacun de ces outils utilise ses propres mots clés. Ils n’opèrent pas de la même façon d’une base à l’autre. Les étudiants arrivent à cette formation avec un a priori négatif. Ils ont le sentiment de maîtriser les techniques de recherche. « Je l’avoue, je suis parti avec un a priori sur ces deux heures. Mais au final, c’était très utile. Les bases de données sont une mine d’or pour les recherches sur le mémoire et nos séances en classe. » Il est donc impératif de sélectionner les outils adéquats, d’établir une relation de confiance, de mesurer les difficultés de ces apprenants bien plus novices qu’ils ne l’imaginaient.
Arabesques, n° 81 (janvier-février-mars 2016). Consulté à l’adresse http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81
Baccino Thierry (2011), « Lire sur internet, est-ce toujours lire ? », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 5, p. 63‑66. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-05-0063-011
Béguin-Verbrugge Annette (2010), préface à L’éducation à la culture informationnelle [actes de colloque], sous la dir. de Françoise Chapron et Éric Delamotte, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, collection Papiers.
Béguin Annette, Chaudiron Stéphane et Delamotte Éric (2007), « Introduction », dossier « Entre information et communication, les nouveaux espaces du document », Études de communication, n° 30, p. 7-12, université de Lille 3. En ligne : https://journals.openedition.org/edc/425
Bélisle Claire (dir.) (2011), Lire dans un monde numérique : état de l’art, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, collection Papiers.
Bermès Emmanuelle (2016), Vers de nouveaux catalogues, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie.
Bouillon Jean-Luc (2015), « Technologies numériques d’information et de communication et rationalisations organisationnelles : les “compétences numériques” face à la modélisation », Les Enjeux de l’information et de la communication, vol. 16/1, n° 1, p. 89-103. En ligne : https ://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-communication-2015-1-page-89.htm
Bretelle-Desmazières Danièle, Coulon Alain et Poitevin Christine (1998), Apprendre à s’informer : une nécessité. Évaluation des formations à l’usage de l’information dans les universités et les grandes écoles françaises, Université de Paris 8, Laboratoire de recherches ethnométhodologiques.
Cardon Dominique et Casilli Antonio A. (2015), Qu’est-ce que le digital labor ?, Bry-sur-Marne, INA Éditions, coll. « Études & controverses ».
Cazaux Marie-Annick et Noël Élisabeth (2005), « Enquête sur la formation à la méthodologie documentaire », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 6, p. 24-28. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-06-0024-003
Chapron Françoise (2015), De la pédagogie du document au curriculum en information-documentation. Dynamiques et résistances, contribution libre pour le 10e congrès des enseignants documentalistes de la FADBEN, Limoges, 9-11 octobre 2015. Disponible en ligne : https://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_01249355/document
De Bonnefond Carole (2017), La formation des usagers en biblbiothèque universiatire : comment mesurer son impact sur la réussite étudiante ?, mémoire d’études DCB, Villeurbanne, Enssib. Disponible en ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67413-la-formation-des-usagers-en-bibliotheque-universitaire-comment-mesurer-son-impact-sur-la-reussite-etudiante.pdf
Dinet Jérôme, Rouet Jean-François et Passerault Jean-Michel (1998), « Les “nouveaux outils” de recherche documentaire sont-ils compatibles avec les stratégies cognitives des élèves ? », Quatrième colloque « Hypermédias et apprentissages », Poitiers, octobre 1998, p. 149-162. En ligne : https://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00000498/document
Fournier Hélène (2007), Stratégies de recherche et de traitement de l’information dans des environnements informatiques et sentiment d’efficacité personnelle des futurs enseignants à l’égard de ces stratégies, thèse, Université du Québec, Montréal.
Gallica, https://gallica.bnf.fr/
Guillaud Hubert (2010), « Le papier contre l’électronique », in Read/Write Book : le livre inscriptible, textes réunis par Marin Dacos, p. 29‑48, Marseille, OpenEdition Press. Consultable en ligne : http://books.openedition.org/oep/128
Ientile Sophie (2016), L’appropriation des pédagogies innovantes par les formateurs en bibliothèques universitaires, mémoire d’études DCB, Villeurbanne, Enssib. Disponible en ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67309-l-appropriation-des-pedagogies-innovantes-par-les-formateurs-en-bibliotheques-universitaires.pdf
Ihadjadene Madjid, Saemmer Alexandra et Baltz Claude (dir.) (2015), Culture informationnelle : vers une propédeutique numérique, Paris, Hermann.
Kennel Sophie (2014), Pratiques et compétences informationnelles des étudiants dans les espaces de formation en ligne, thèse de doctorat, université de Strasbourg. En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01148915/document
Ladage Caroline (2017), Enquêter pour savoir : la recherche d’information sur Internet comme solution et comme problème, Presses universitaires de Rennes.
Lambert Vincent (2013), « La Documentation électronique à l’université de Nice », Bulletin des bibliothèques de France (BBF), n° 1, p. 50-56. Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-01-0050-012
LISEC (Laboratoire interuniversitaire des sciences de l’éducation et de la communication) (2016), Articulation et collaboration entre les équipes pédagogiques et les services de documentation au coeur de la transformation pédagogique de l’enseignement supérieur. En ligne : https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67093-articulation-et-collaboration-entre-les-equipes-pedagogiques-et-les-services-de-documentation-au-coeur-de-la-transformation-pedagogique-de-l-enseignement-superieur.pdf
Zacklad Manuel (2019), « Le design de l’information : textualisation, documentarisation, auctorialisation », Communication & langages, n° 199, p. 37-64. En ligne : https://www.cairn.info/revue-communication-et-langages-2019-1-page-37.htm
Maury Yolande, Kovacs Susan et Condette Sylvie (dir.) (2018), Bibliothèques en mouvement: innover, fonder, pratiquer de nouveaux espaces de savoir, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, coll. « Information – Communication ».
1. Selon la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, les ÉSPÉ sont renommées « instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation » (INSPÉ).
Si dans le milieu des bibliothécaires, et des bibliothèques universitaires en particulier, des enjeux légitimes animent la profession (innovation pédagogique et réussite étudiante, services à la recherche ou encore liberté et gratuité d’accès aux ressources scientifiques, articles ou encore données de la recherche), une profession plus discrète, celle de documentaliste, porte des enjeux non moins importants et vitaux.
Qu’il s’agisse seulement de nommer les documentalistes hospitaliers, dont la recherche ou la veille peut littéralement sauver la vie d’un ou plusieurs patients, en hôpital général comme en psychiatrie. C’est principalement rattachés à ces institutions que se sont développés les Centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (CRIAVS).
S’il est important cette année de célébrer leur réseau de centres documentaires, ce n’est pas simplement parce qu’il a dix ans. C’est aussi parce que, par sa problématique, il résonne avec des enjeux particulièrement brûlants de nos jours : violences sexuelles et violences de genre. Les CRIAVS sont des centres ressources interdisciplinaires et interprofessionnels qui ont pour vocation de rassembler les ressources en termes d’expertise humaine, de recherche scientifique et de documentation autour de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles (AVS) : autant dans les domaines juridiques, criminologiques, psychologiques, psychiatriques, sociologiques ou encore éthiques. Au-delà de la prise en charge judiciaire, sociale ou encore sanitaire des AVS, on peut donc cerner leur impact sur la société. En effet, les violences sexuelles laissent chez leurs victimes, hommes, femmes ou enfants, des blessures intimes souvent invisibles mais indélébiles. Les professionnels de ce réseau constituent le nerf vital qui assure une veille interdisciplinaire sur cette thématique, et organise et signale cette information pour la diffuser aux intervenants de la santé, de la justice et du social. Autant dire que ces hommes et ces femmes de l’ombre contribuent – certes discrètement – aux avancées qui permettent en France de mieux maîtriser les questions de violences genrées et sexuelles.
La circulaire DHOS/DGS/02/6C no 2006-168 du 13 avril 2006 relative à la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et à la création de centres de ressources interrégionaux stipule que les CRIAVS doivent : « Rechercher, rassembler, mettre à la disposition et faire connaître des professionnels toute la documentation et la littérature sur les auteurs de violences sexuelles. »
Cette circulaire répondait intelligemment à un constat simple : la documentation existait mais était difficilement ou pas accessible, charge aux CRIAVS de la structurer et d’en simplifier l’accès aux professionnels, afin que ces documents scientifiques permettent l’amélioration de la prise en charge des patients et contribuent à la prévention des violences sexuelles, notamment en matière de récidive.
Mettre en place un tel système d’information documentaire constituait alors un véritable défi. Bibliothécaires, documentalistes, informaticiens, juristes, secrétaires formés en documentation… les profils pouvant travailler en commun ne manquaient pas pour mettre en place cette organisation, en collaboration avec les acteurs du soin spécialistes du domaine : psychiatres, psychologues, infirmiers, éducateurs, psychomotriciens… Cette multidisciplinarité a permis la professionnalisation et la montée en compétences de personnels non destinés au départ aux métiers de la documentation.
La documentation des CRIAVS a débuté sa structuration courant 2008 avec la création des bases de données documentaires des CRIAVS RA en collaboration avec le CRIAVS Picardie – base qui prendra le nom de Thèséas1 –, et du CRIRAVS PACAC2 – base qui restera indépendante –, d’autres centres ressources régionaux ayant fait le choix, pour des raisons techniques et institutionnelles, d’un système documentaire local tout en participant activement au réseau national de veille et d’échange d’informations et de documents. Embryonnaire et confidentiel jusque-là, c’est en juin 2009 que le réseau documentaire des CRIAVS fut officiellement lancé dans le cadre de la Fédération nationale des CRIAVS devenue depuis la Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS) [4]. Thèséas fut proposé et accepté comme catalogue dans lequel serait rassemblé l’ensemble des références documentaires. Cependant, il restait à créer de véritables liens entre les professionnels chargés de la documentation, en d’autres termes favoriser la communication entre eux. Au-delà des positionnements et politiques différentes suivant les centres ressources. Il fallait d’une part impliquer les professionnels, mais aussi leur hiérarchie, afin qu’elle puisse leur dégager du temps pour ce travail, et d’autre part prouver qu’une mutualisation des moyens était profitable à tous.
Il fut donc nécessaire de faire un état des lieux, des disponibilités et compétences de chaque professionnel impliqués dans la documentation, de rédiger une charte, d’entamer un processus de formation afin que tous « parlent la même langue », d’insuffler un esprit de réseau via des réunions, et renforcer les interactions par des réalisations communes.
Les tout premiers documentalistes et bibliothécaires des CRIAVS étaient motivés mais en nombre insuffisant. En effet, très peu d’entre eux étaient à temps plein sur cette fonction (ce qui est toujours le cas aujourd’hui) : seuls quatre CRIAVS sur plus d’une quinzaine avaient un professionnel de l’information à temps plein, les autres utilisant le service documentaire déjà présent dans leur établissement.
D’autres CRIAVS firent le choix de donner du temps de documentation aux secrétaires motivés, documentalistes en devenir, souhaitant se former dans le domaine des sciences de l’information.
Si, dans certains CRIAVS, la distinction est nette entre secrétariat et missions documentaires, dans d’autres, une seule personne cumule ces fonctions, de manière à satisfaire toutes les demandes en restant concentrée et efficace pour le bien de son équipe et de ses usagers. En effet, les fonctions documentaires dans la fonction publique hospitalière souffrent d’un flou statutaire qui nuit à leur identité comme à la reconnaissance de leur spécificité et de leur expertise dans le domaine de l’information scientifique et technique (IST).
Comment les professionnels concilient-ils ces missions antagonistes ? Même s’il existe des profils de poste « secrétaire documentaliste », il est évident que les missions ne sont pas les mêmes.
La gageure, pour ces agents, est de mener de front des fonctions administratives, d’accueil et de service public (les secrétariats sont en quelque sorte les vitrines d’un service de santé) avec les fonctions techniques et scientifiques de documentaliste, en faisant en sorte que l’une ne prenne pas le pas sur l’autre : les deux étant légitimement chronophages et exigeantes, mais surtout dissemblables.
Ce défi quotidien est difficile mais valorisant pour les agents qui ont l’occasion d’élargir leur horizon professionnel et d’acquérir, notamment par la formation organisée au sein du réseau, de nouvelles compétences professionnelles.
D’autres profils sont plus originaux, et apportent un point de vue différent sur la documentation.
Citons en exemple le CRIAVS Poitou-Charentes, qui fut, dans le cadre de son association avec l’URC Pierre Deniker de Poitiers en 2011, le premier à recruter une personne faisant fonction de documentaliste dotée d’un doctorat en biologie ; outre la gestion du fonds documentaire, celle-ci fut également chargée de l’organisation de la recherche.
Ses missions consistent notamment à mettre en place les études cliniques puis, ensuite, à veiller à ce que le déroulement de ces dernières suive leurs protocoles respectifs et la législation en vigueur ; de même, elle vérifie la qualité et la fiabilité des données recueillies auprès des volontaires ou des patients inclus. Durant son cursus universitaire, elle a appris à sélectionner des articles scientifiques (principalement anglophones) à partir de bases de données telles que PubMed, à les analyser et à les référencer selon des normes précises. Elle a également acquis une expérience plus ou moins importante dans la rédaction de communications écrites et la création de communications affichées (ou posters).
Transposées dans le cadre d’une fonction de documentaliste, ces compétences lui permettent de procurer aux investigateurs des articles sur des sujets ciblés afin de les aider, d’une part à élaborer le protocole en amont de l’étude, et d’autre part à rédiger la publication des résultats découlant de cette dernière. De plus, l’organisatrice met à profit ses habitudes de lecture critique et de synthèse de textes, pour rédiger des revues de la littérature éditées par des revues scientifiques, et pour confectionner des posters présentés lors de congrès.
Afin d’établir un consensus sur un fonctionnement collectif, une charte, validée en réunion plénière le 17 octobre 2010 par l’ensemble du réseau documentaire, a été mise en place. Elle a été signée par les responsables de service, ainsi que par le chargé de documentation de chaque CRIAVS, intéressé par une mutualisation des compétences et de l’information.
De plus, pour que tous les membres du réseau puissent échanger sur des bases communes, des formations ont été organisées. Ces formations ont été élaborées et effectuées en interne par les documentalistes du réseau professionnel, spécialistes en IST ou en veille informationnelle.
Collectives à l’origine, ces formations ont évolué vers des sessions personnalisées, permettant une prise de fonction rapide des nouveaux arrivants, mais aussi aux plus anciens de se perfectionner. Ces formations sont de plusieurs types, la liste est non exhaustive et peut dépendre de besoins individuels ;
– techniques de la documentation ;
– SIGB (Thèséas) ;
– veille d’informations ;
– entretien des connaissances.
Afin de faire le point et de mettre en place des projets communs, des réunions deux fois par an du réseau documentaire se sont très vite imposées. Parfois des réunions complémentaires, principalement téléphoniques, s’intercalent pour travailler certains dossiers précis. Enfin, une rencontre de la commission documentation est systématiquement organisée à chaque Conseil d’administration de la FFCRIAVS.
Thèséas est le catalogue en ligne du réseau documentaire de la FFCRIAVS. Forte de plus 8 000 notices sur les AVS, cette base de données interrégionale est unique en France sur cette thématique spécifique.
L’évolution des technologies entraîne la nécessité de mettre à jour le portail documentaire vieillissant, permettant une consultation aisée de références documentaires. Un groupe de travail a donc été constitué, et le déploiement de ce nouveau portail sera effectif courant 2019, celui-ci pourra notamment s’adapter à tous formats d’écran. Toutefois, l’affichage extérieur de la documentation n’est rien sans une organisation efficace de son contenu.
Ascodocpsy3 est le réseau documentaire national le plus important en santé mentale. Celui-ci a développé un thésaurus qui est la référence pour les documentalistes hospitaliers dans ce domaine. Afin de faciliter le signalement des ressources documentaires relatives à la prise en charge des AVS, un groupe de travail de documentalistes des CRIAVS a enrichi ce recueil de mots-clés de termes spécifiques aux violences sexuelles, en ayant bien en tête dans un sujet aussi sensible l’esprit de la citation d’Albert Camus selon laquelle « mal nommer les choses, c’est ajouter du malheur au monde ».
De plus, dans un souci de mutualisation des moyens, les professionnels du réseau documentaire de la FFCRIAVS ont décidé de mettre en place un groupe de travail en 2016, pour créer une classification commune à tous les CRIAVS. Celle-ci a été déployée sous Thèséas en juillet 2017.
Cette classification est un outil supplémentaire d’organisation et de consultation du fonds documentaire national. En effet, elle permet de classer l’ensemble des documents des CRIAVS par grands thèmes, et de faciliter les recherches d’informations via le portail documentaire.
Le réseau documentaire s’est particulièrement investi dans la création du site internet de la FFCRIAVS. Ce dernier est aujourd’hui la plateforme de référence concernant la prise en charge des AVS. Il possède des ressources propres et est connecté à la base de données documentaire Thèséas. C’est également à partir de cette plateforme que le bulletin de la documentation nationale est envoyé.
En effet, grâce à la mutualisation des moyens du réseau, un bulletin d’information national hebdomadaire est diffusé par courriel, à l’ensemble des professionnels qui le souhaitent4. Pour pouvoir l’alimenter en plus de saisies de notices dans Thèséas, une veille d’informations a été organisée. Elle est constituée des classiques partages de liens, mais aussi d’informations remontées par Tiny Tiny RSS l’outil de veille de la FFCRIAVS.
Avec le temps, le réseau documentaire de la FFCRIAVS a tissé des liens solides avec le réseau Ascodocpsy et l’Association Docteurs Bru5. D’autres partenariats sont également à l’étude au cours de l’année 2019, y compris à l’international.
Trois communications scientifiques présentées au Congrès international francophone sur l’agression sexuelle (CIFAS), balayant divers aspects du réseau documentaire, ont été élaborées : en 2013, une présentation globale du réseau documentaire [1] ; en 2015, les outils destinés à l’évaluation des patients [3] ; et en 2017, le soutien qu’apporte la documentation à la recherche [5].
Une communication présentée en 2016 au congrès de l’International Association for the Treatment of Sexual Offenders (IATSO) est une traduction en anglais de la présentation du réseau documentaire de 2013 [2].
Le réseau documentaire a également su répondre aux besoins de l’audition publique de juin 2019 organisée par la FFCRIAVS, représentant 6 mois de travail et plus de 800 demandes d’experts satisfaites, et ayant donné lieu à 35 propositions pour lutter efficacement contre les violences sexuelles6.
Nous avons vu que les documentalistes n’étaient pas seulement fournisseurs de documents, mais aussi acteurs de cette documentation par la veille d’informations, la conception d’outils adaptés à des demandes exigeantes et diverses, donnant lieu parfois à l’élaboration de documents nouveaux. Bibliographies, bulletins d’informations, communications scientifiques, ne sont que quelques exemples qui mettent en lumière un fait rarement évoqué concernant cette profession, à savoir l’alimentation du fonds par des documents créés par les documentalistes eux-mêmes, ce qui n’est pas toujours chose aisée.
Au cours de ces dix années d’existence, le réseau documentaire de la FFCRIAVS a pourtant su relever de nombreux défis : s’organiser, échanger, se former, faire évoluer ses outils, et s’ouvrir vers l’extérieur. Tout cela au service des professionnels en contact avec les AVS, afin que leur prise en charge puisse s’enrichir des derniers écrits, outils… sur cette problématique.
Compte tenu de ses réalisations, il apparaît aujourd’hui que le réseau documentaire, avec le soutien de la FFCRIAVS, et grâce au dynamisme de ses membres, est prêt à relever les défis à venir.
[1] ANTONA Éric, RICHEROT Lucile et MESGUICH Marie, Recherche et documentation : l’information documentaire pour la recherche scientifique, poster de communication [acte de colloque], série « CIFAS 2017 : Quand la clinique rencontre la recherche », Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS), 2017. https://theseas.reseaudoc.org/index.php?lvl=notice_display&id=17522
[2] ANTONA Éric, CANO Jean-Philippe, LAMBRINIDIS Claire, RICHEROT Lucile et VEILLEROT Frédéric, Plurality and complexity of literature dealing with sex offenders : Unicity of knowledge and experiences of a french network of resource centres [Pluralité, complexité de la documentation traitant de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles : le réseau documentaire, unicité d’expériences et de connaissances], poster de communication [acte de colloque], série « IATSO 2016 », Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS), 2016. https://theseas.reseaudoc.org/index.php?lvl=notice_display&id=18451
[3] TRAORÉ-LEFÈVRE Simone, RICHEROT Lucile, VANDERSTUKKEN Olivier et ANTONA Éric, Création d’un répertoire des outils d’évaluation des auteurs d’agression sexuelle (AAS) (tests, échelles, questionnaires d’évaluation clinique), poster de communication [acte de colloque], série « CIFAS 2015. L’agression sexuelle : réalités multiples, approches adaptées », Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS), 2015. https://theseas.reseaudoc.org/index.php?lvl=notice_display&id=18449
[4] CANO Jean-Philippe, « Violences sexuelles – Les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles : les CRIAVS, dans Psychiatrie légale et criminologie clinique, sous la dir. de Jean-Louis Senon, Carol Jonas et Mélanie Voyer, Elsevier Masson, 2013, coll. « Les âges de la vie », p. 343-346.
[5] ANTONA Éric, LAMBRINIDIS Claire, RICHEROT Lucile et VEILLEROT Frédéric, Pluralité, complexité de la documentation traitant de la prise en charge des auteurs de violences sexuelles : le réseau documentaire, unicité d’expériences et de connaissances, poster de communication [acte de colloque], série « CIFAS 2013. L’agression sexuelle : unicité, pluralité, complexité », Fédération française des CRIAVS (FFCRIAVS), 2013. https://theseas.reseaudoc.org/index.php?lvl=notice_display&id=4398
1. https://theseas.reseaudoc.org/
2. Aujourd’hui CRIR AVS PACA : Centre ressources pour les intervenants de la région PACA dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles. https://criravspaca.centedoc.fr/
3. https://www.ascodocpsy.org/
4. http://www.ffcriavs.org/ressources/bulletins-documentaire/
5. https://www.associationdocteursbru.org/
En février 2018, à l’occasion d’une recherche en histoire des sciences menée dans les fonds anciens de la bibliothèque universitaire des sciences et techniques (BUST) de l’université de Bordeaux, nous avons découvert un portrait gravé inédit, qui semble être un autoportrait de madame Lavoisier. Après avoir décrit le contexte de cette découverte et montré l’intérêt d’étudier les fonds anciens, nous nous attarderons sur cette gravure et nous expliquerons pourquoi l’hypothèse de l’autoportrait de madame Lavoisier est la plus probable.
En 1995, à l’occasion du bicentenaire de la mort de Lavoisier, René Maury, à l’époque conservateur à la BUST de l’université de Bordeaux, a rédigé une brochure sur la collection Lavoisier possédée par la bibliothèque [Maury, 1995]. Il y recense soixante-sept titres, portant tous l’ex-libris gravé ou manuscrit de Lavoisier, dont il donne les caractéristiques bibliographiques principales et une courte biographie des auteurs. Dans le cadre d’un mémoire de recherche de master en épistémologie et histoire des sciences mené en 2018 à l’université de Bordeaux Montaigne, nous avons examiné en détail ces ouvrages. Cette collection Lavoisier fait partie du fonds Baudrimont (1806–1880), fonds acquis par la bibliothèque en 1880, à la mort de ce professeur de chimie à la faculté des sciences de Bordeaux, et nous remercions la BUST qui nous a fort gentiment permis d’accéder à ce fonds ancien. Lors de ce travail, nous avons identifié d’autres livres ayant appartenu à Lavoisier et la collection compte désormais soixante-treize titres. Le 1er février 2018, nous avons découvert une gravure, dans le troisième tome des Expériences physiques et chymiques, sur plusieurs matières relatives au commerce & aux arts du pharmacien et médecin anglais William Lewis (1714–1781), traduit par Philippe-Florent de Puisieux et publié en 1769. Cette épreuve était insérée entre les pages 356 et 357 du livre, au début d’un passage sur le platine. Cette place incongrue pour une telle gravure, un petit portrait de femme en plein milieu d’un ouvrage de chimie, fait penser aux cartes à jouer qui étaient utilisées parfois comme marque-page. Ni René Maury ni Marco Beretta, qui a pour sa part publié en 1995 Bibliotheca Lavoisieriana : the catalogue of the Library of Antoine Laurent Lavoisier [Beretta, 1995], n’évoquent la présence de cette gravure. La bibliothèque universitaire ne l’avait pas répertoriée non plus et nous n’en avons pas trouvé mention ailleurs.
Cette découverte présente un double intérêt. Elle est importante par son existence même, et nous nous attarderons dans un second temps sur ce portrait inédit, sa description, les hypothèses sur la femme représentée et sur l’auteur de cette gravure. Cette découverte montre par ailleurs la nécessité d’une étude méticuleuse des fonds anciens et de leur histoire afin, justement, de trouver d’éventuels documents inédits et de comprendre la cohérence de tel ou tel fonds. Ainsi la collection Lavoisier identifiée par René Maury en 1995 appartient au fonds Baudrimont, dont nous allons décrire l’historique. Dans les Actes de l’Académie nationale de sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux publiés à Paris en 1897, Georges Rayet (1839–1905), alors professeur à la faculté, retrace l’histoire de la faculté des sciences de Bordeaux entre 1838 et 1894. Il consacre notamment un large passage à Alexandre-Edouard Baudrimont (1806–1880), professeur de chimie à la faculté des sciences de Bordeaux de 1866 à 1878 et collectionneur d’ouvrages scientifiques anciens. À sa mort, sa famille a permis à la faculté de Bordeaux « avant toute vente, de choisir les cinq cents volumes qui constituent aujourd’hui le fonds Baudrimont » [Actes, 1897]. Georges Rayet précise que ce fonds contient notamment « quatre-vingts volumes provenant de la bibliothèque de Lavoisier, portant l’ex-libris et la signature du savant intendant, et comprenant une série de traités de chimie publiés de 1688 à 1785 » [Actes, 1897]. Il cite Herman Boerhaave (1668–1738), Jean D’Arcet (1725–1801), Antoine-François Fourcroy (1755–1809), Jean-Claude De La Metherie (1743–1817), Nicolas Le Fevre (1610–1699), Pierre-Joseph Macquer (1718–1784), Antoine Baume (1728–1804) et Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) comme exemples d’auteurs entrant dans cette collection. Le fonds ainsi constitué au début des années 1880 a dû être catalogué puisque les différents ouvrages portent tous une cote. Ce fonds a ensuite été déplacé à plusieurs reprises au gré des changements de locaux des bibliothèques universitaires. Depuis 2010, Mireille Bravo, bibliothécaire, s’est occupée de traiter le fonds ancien de la BUST et de mettre à jour le catalogue Sudoc1 afin de rendre accessible à tous les informations concernant ces ouvrages.
Le papier sur lequel a été réalisée l’impression est assez épais. Il s’agit soit d’un vélin soit d’un vergé assez fort. Il est enfoncé sur un carré de 43 mm de côté et l’impression est presque centrée sur une feuille de 67 mm de haut et 55 mm de large. La technique utilisée est soit une eau-forte soit un essai d’aquatinte. Le décrochement de la plaque de cuivre au niveau du bord inférieur se traduit par une morsure de la cuvette. L’ensemble de ces détails laisse à penser qu’il s’agit d’une gravure d’amateur. Le sujet représenté est un portrait de femme, de trois quarts avant, la tête légèrement penchée à droite, et de couleur bistre. Le visage, de forme plutôt ovale, est assez lisse. Il semble impassible. La bouche étroite et les yeux aux sourcils rehaussés sont délicatement tracés. Le nez est dessiné de façon beaucoup moins délicate, d’un trait lourd et noir, représentant à la fois le bord inférieur de l’aile droite, la narine et l’ombre du lobe. Rien ne marque la partie supérieure de l’aile, non plus que la frontière latérale du lobe. Le front est en partie couvert par la coiffure. Les cheveux sont bouclés, mi-longs, ils cachent l’oreille droite du sujet et semblent retenus par un bandeau. Les joues sont très peu dessinées et le menton est très arrondi. Le haut du buste est esquissé et montre des épaules étroites sur lesquelles retombent quelques boucles de cheveux. Un début de vêtement avec une échancrure en V est dessiné. Le drapé de l’étoffe est rendu par de brefs traits droits, relativement peu épais. Xavier Seydoux2, directeur de la galerie Seydoux à Paris, membre de la Chambre syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau, et expert de la CNES (Compagnie nationale des experts spécialisés), estime que cette épreuve a été réalisée entre 1770 et 1830. Le petit format utilisé était d’usage courant à cette période afin de réaliser des essais en une dizaine d’exemplaires, vingt au maximum.

Figure 1. Un portrait inédit de madame Lavoisier3 ?
Nous faisons l’hypothèse que ce portrait peut être celui de madame Lavoisier, réalisé de sa propre main. Pour appuyer cette double thèse, à laquelle souscrit Patrice Bret, secrétaire général du Comité Lavoisier de l’Académie des sciences, à qui nous l’avons soumise, nous nous intéresserons à la physionomie du sujet ainsi qu’à la technique utilisée.
Cette gravure se trouvait dans un livre ayant appartenu à Antoine Laurent Lavoisier. On peut donc penser que c’est le portrait d’une femme de son entourage. Mais les époux Lavoisier n’ont pas eu de fille. Madame Lavoisier n’a pas de sœur et celle de son mari est décédée à quinze ans, en 1760, onze ans avant leur mariage. Reste la possibilité que ce soit madame Lavoisier elle-même. En 1788, le peintre Jacques-Louis David réalise le célèbre portrait des époux Lavoisier4, exposé au Metropolitan Museum of Art de New York, à la demande de madame Lavoisier, laquelle était l’élève du peintre à partir de 1786 [Pinault-Sørensen, 1994]. Elle a réalisé notamment les gravures qui illustrent le Traité élémentaire de chimie que son mari publie en 1789. En 1790, David peint également le portrait des deux filles du banquier Jacques Rilliet : le Portrait de la marquise d’Orvilliers5, aujourd’hui visible au Musée du Louvre à Paris, qui représente Jeanne-Robertine Rilliet, et le Portrait de la comtesse de Sorcy-Thélusson6, qui figure sa sœur, Louise Rilliet, conservé par le musée Neue Pinakothek de Munich. Leurs figures présentent de nombreux traits de ressemblance avec le portrait que nous avons découvert. Nous pouvons nous demander si madame Lavoisier n’a pas rencontré les filles Rilliet ou si elle n’a pas pu voir David travailler sur ces peintures, reproduisant elle-même peut-être les portraits à titre d’exercice. Notre gravure pourrait donc être le portrait soit de madame Lavoisier elle-même, soit de l’une ou l’autre des deux sœurs Rilliet.
Lequel de ces trois portraits se rapproche le plus de celui que nous avons découvert ? La technique des logiciels de reconnaissance faciale basée sur la cartographie des visages permet de comparer ces différents portraits entre eux et d’apporter une réponse. En effet, l’écartement des yeux, les arêtes du nez, la commissure des lèvres, des oreilles, la distance entre le menton et la lèvre inférieure comptent parmi les caractéristiques clés d’un visage. Pour chacun des trois portraits et pour la gravure, nous avons repéré la position des yeux et du nez, les positions extrêmes de la bouche, la position de l’extrémité du menton et celle du bas des oreilles (pour faciliter la comparaison avec notre gravure, nous avons réalisé une symétrie par rapport à un axe vertical du visage de la marquise et de celui de la comtesse car elles regardaient à gauche à l’origine alors que le visage de la gravure est orienté à droite). Nous avons effectué ce travail à l’aide d’un logiciel de traitement d’image. Nous avons ainsi obtenu uniquement les points caractéristiques, ce qui nous a ensuite permis, toujours à l’aide du même logiciel de traitement d’image, de superposer la configuration obtenue pour chaque visage avec la configuration obtenue pour la gravure.
Les points caractéristiques du visage de la gravure coïncident bien plus avec le portrait de madame Lavoisier (c’est-à-dire celui qu’elle offre sur le tableau où David la peint avec son mari) qu’avec celui de la comtesse de Sorcy ou celui de la marquise D’Orvilliers. Par ailleurs, madame Lavoisier a peint un autoportrait de profil, peut-être sous la supervision de David lui-même [Beretta, 2001], sur lequel elle présente un visage moins fin que celui du portrait des époux Lavoisier réalisé par le peintre. Malgré la difficulté à comparer ces deux images à l’angle très différent et à des âges distants, la physionomie de madame Lavoisier sur cet autoportrait est assez proche de celle de notre gravure.
Des logiciels ou applications en ligne permettent d’effectuer une analyse similaire. Microsoft7 et Amazon8 proposent ainsi un logiciel de reconnaissance faciale basé sur ce principe. L’application Azure de Microsoft donne par exemple une fiabilité de 74 % de correspondance entre la gravure et le portrait de madame Lavoisier, alors qu’elle est de 63 % avec la comtesse de Sorcy et seulement de 54 % avec la marquise d’Orvilliers.
Une approche complémentaire consiste à comparer notre gravure avec un dessin réalisé par madame Lavoisier, Lavoisier dans son laboratoire : Expériences sur la respiration de l’homme exécutant un travail (voir figure 2). Ces deux dessins emploient des techniques très différentes : trait et lavis pour le dessin, contre une gravure relativement plus épaisse. Cependant, ils présentent des ressemblances en matière de technique de représentation des sujets, qui pourraient confirmer qu’ils sont de la même main. Le premier point concerne la forme des drapés. Dans le dessin, madame Lavoisier se représente avec un vêtement drapé sur les épaules. Nous avons déjà noté le travail particulier sur le drapé de la gravure : le dessin de madame Lavoisier emploie une technique similaire, à base de traits brefs et droits, quasi verticaux. Une deuxième similitude est à chercher dans le dessin du nez. Celui-ci détonne dans le modelé relativement délicat de la gravure. Dans le dessin, la troisième personne sur la gauche – un assistant de Lavoisier – est représentée de trois quarts avant dans une posture proche de celle du portrait de la gravure. Son nez est dessiné d’un trait, englobant là aussi l’ombre de l’aile, la narine et l’ombre du lobe, allié à un trait vertical qui figure le dos de l’organe. Cette ressemblance est notable dans la mesure où le nez est l’une des parties du visage pour laquelle s’exercent des choix très divers en matière de représentation. Dans ces deux illustrations, l’artiste ou les artistes semblent donc avoir opté pour des options similaires, quand d’autres conventions de représentation étaient disponibles. Les résultats de cette étude stylistique appuient donc le second volet de notre hypothèse : le portrait ne représente pas seulement madame Lavoisier, il semble être de sa main.
Il est bien entendu difficile d’acquérir une certitude quant à l’auteur de notre gravure et à son sujet. Mais les conditions de la découverte, la facture de l’illustration et les relevés physionomiques, croisés avec les représentations connues de l’entourage des époux Lavoisier, nous amènent à conclure qu’il s’agit bien là d’un autoportrait de madame Lavoisier, probablement réalisé par elle-même aux alentours des années 1790.

Figure 2. Marie-Anne Pierrette Lavoisier, Lavoisier dans son laboratoire : Expériences sur la respiration de l’homme exécutant un travail, coll. part.
Mireille Bravo, Patrice Bret, Pascal Duris, Claire-Lise Gauvain, Nicolas Labarre, Xavier Seydoux et Romain Wenz.
Jacques-Louis David, Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794) et sa femme (Marie Anne Pierrette Paulze, 1758–1836).

Jacques-Louis David, Portrait de la marquise d’Orvilliers.

Jacques-Louis David, Portrait de la comtesse de Sorcy-Thélusson.

Marie-Anne Pierrette Lavoisier, Autoportrait de madame Lavoisier.

Actes de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, Paris, 1897.
AKAMATSU Shigeru, SASAKI Tsutomu, FUKAMACHI Hideo, MASUI Nobuhiko et SUENAGA Yasuhito, « An accurate and robust face identification scheme », Proceedings, 11th IAPR International Conference on Pattern Recognition. Vol. II. Conference B : Pattern Recognition Methodology and Systems, La Hague, IEEE, 1992, p. 217-220.
BERETTA Marco, Bibliotheca Lavoisieriana : the catalogue of the library of Antoine Laurent Lavoisier, Florence, L. S. Olschki,, 1995.
BERETTA Marco, Imaging a career in science : the iconography of Antoine Laurent Lavoisier, Bologna studies in scientific heritage 1. Canton, Mass : Science History Publications/USA, 2001.
DAVID Jacques Louis Jules, Le peintre Louis David, 1748–1825, Vol. 1 : Souvenirs & documents inédits, Paris, 1880.
MAURY René et Université Bordeaux I, Service commun de la documentation, Lavoisier, ex-libris : une collection bordelaise, SICOD-Bibliothèque universitaire des sciences et techniques [de] Bordeaux, 1995.
PINAULT-SØRENSEN Madeleine, « Madame Lavoisier, dessinatrice et peintre. », Musée des Arts et Métiers : La revue, n° 6, mars 1994.
1. Système universitaire de documentation.
2. Nous remercions chaleureusement Claire-Lise Gauvain, chargée de valorisation documentaire à la direction de la documentation de l’université de Bordeaux, et Romain Wenz, responsable du service du patrimoine documentaire à la direction de la documentation de l’université de Bordeaux, qui ont accepté que ce portrait quitte les locaux de la BUST de Bordeaux afin d’être expertisé à Paris par Patrice Bret et Xavier Seydoux le 19 juillet 2018.
3. Disponible à l’adresse suivante : http://www.babordnum.fr/items/show/1088
4. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/436106
5.http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=obj_view_obj&objet=cartel_22506_33187_rf2418.jpg_obj.html&flag=true
6. https://www.pinakothek.de/kunst/meisterwerk/jacques-louis-david/anne-marie-louise-thelusson-comtesse-de-sorcy
7. https://azure.microsoft.com/fr-fr/services/cognitive-services/face/
Le BBF est amené à se repenser dans le contexte de dématérialisation et d’évolution des pratiques.
Le numéro 17/18 « Habiter la Bibliothèque » est le dernier à paraître sous la forme de la série actuelle ; il clôt tous les abonnements en cours.
Il n’y a pas eu de campagne d’abonnements en 2019 et il n’en interviendra plus.
Dans les mois qui viennent, la revue va se renouveler à partir d’une offre web, toujours accessible gratuitement.
Nous remercions nos fidèles lecteurs et leur donnons rendez-vous à la fin de l’année.
La rédaction
Engageant dès leur signature des dépenses importantes, les négociations portées par le consortium Couperin, en particulier dans le cas des licences nationales, sont menées suivant une méthode dont ces lignes interrogent la performance avant de proposer une alternative plus transparente et collaborative, dont on peut imaginer qu’elle serait plus efficace in fine.
Le 16 avril 2019, le blog The Sound of Science 1 diffusait une lettre d’accord de principe 2 datée du 11 avril 2019, envoyée par la présidente du consortium Couperin à l’éditeur Elsevier, et esquissant un protocole d’accord à finaliser entre les parties engagées dans la préparation de la licence nationale Elsevier prévue pour s’étendre de 2019 à 2022.
Dans ce courrier, au-delà de l’esquisse d’un certain nombre de dispositions pour le moins discutables 3 et ayant donné lieu à plusieurs prises de positions officielles de structures concernées au premier chef 4, le point 8, intitulé plus précisément « Communication et confidentialité », ne laissait pas de surprendre, sa teneur valant bien qu’on le cite in extenso :
« À défaut de confidentialité, clause contraire à la politique de transparence engagée par le gouvernement français et que nous ne pouvons de toute façon pas assurer, Elsevier et Couperin assureront une communication officielle coordonnée concernant les contenus de l’accord.
Ce projet d’accord ouvre la voie — sous la condition de consolider préalablement l’engagement des établissements sur cette base — vers la signature par Couperin, l’ABES et Elsevier d’un protocole d’accord. L’accord sera rendu public au plus près de la signature du protocole, qui sera suivie de la rédaction du marché public concrétisant juridiquement la licence nationale 2019-2022. » 5
À la lecture, ce point 8 réussit la performance d’indiquer que le consortium ne peut assurer la confidentialité des accords le liant à Elsevier tout en traçant une démarche de publicisation d’un protocole au plus tard possible, ce qui ressemble tout de même bien à une intention de confidentialité sans doute d’ailleurs très fortement demandée/attendue par l’éditeur.
Ici émerge à nouveau le débat entre, d’une part, les partisans d’une transparence la plus poussée possible autour des négociations menées par le Consortium ; et d’autre part, les tenants d’une discrétion de bon aloi seule à même, selon ses supporters, de permettre de mener au plus les gains desdites discussions commerciales.
Rappelons à cet égard le fonctionnement des montages de licence nationale : après enquête vers les établissements, élaboration de différents scénarios puis définition et validation d’un mandat 6 par Couperin, une poignée (trois personnes pour la licence nationale Elsevier, selon le site Couperin) de collègues courageux/courageuses, dont il faut souligner ici l’engagement comme le travail, se chargent pour le consortium de la négociation avec le fournisseur, jusqu’à l’aboutissement d’un accord signé puis rendu (relativement) public dans ses composantes financières et ses conditions détaillées.
Ce fonctionnement, s’il participe à l’élaboration d’un mandat issu a priori d’un consensus, pose problème à plus d’un titre :
Au final, ces processus demeurent très largement verticaux et opaques, à l’agent comme au chercheur, sans parler du citoyen lambda qui, lui, n’entendra jamais parler, ni ne pourra participer à des discussions commerciales où s’engagent pourtant des centaines de millions d’euros d’argent public.
Face à ces pratiques relevant d’un temps à présent dépassé, en notre époque qui a enfin compris que la transparence était un élément fondamental des politiques publiques, on ne peut alors s’empêcher de penser à des pratiques que l’on voit émerger, engageant une communauté dans des processus de discussions et de décisions réellement collaboratifs.
Si ces méthodes de démarches participatives citoyennes se répandent (conseils citoyens ou locaux, budget collaboratif, etc.), le plus bel exemple récent est sans doute la phase préalable à la rédaction de la loi pour une République numérique, dite loi Lemaire qui, utilisant un outil particulièrement bien conçu 8, a permis de rassembler, dans les quelques jours s’étant écoulés du 26 septembre 2015 au 18 octobre 2015, 8 492 contributions, 147 549 votes, et 21 4729 participants – une performance à saluer sur un sujet pour le moins aride.
En l’occurrence et concernant les négociations évoquées ici, dont en particulier les licences nationales de type Elsevier, une démarche innovante pourrait être la suivante :
Évidemment, cette manière de travailler serait réservée aux seules licences nationales dépassant une barre financière au-delà de laquelle toute négociation devrait impérativement utiliser cette méthode conforme aux objectifs de transparence déjà évoqués, et dont on peut penser qu’elle recèle plusieurs avantages :
Enfin, last but not least, une négociation publique serait de nature à casser la dynamique d’un modèle de négociation classique où le vendeur utilise la méthode datée mais encore efficace du secret partagé 9, laissant croire à son client que les conditions qu’il lui accorde sont des conditions privilégiées qu’il convient de ne pas laisser sortir du cadre de la négociation pour qu’elles (ces conditions) puissent rester privilégiées – évidemment, il n’en est rien.
Dans cet ordre d’idées d’ailleurs, pour finir, une négociation plus transparente aurait également sans doute des effets positifs dépassant nos frontières, son aspect public permettant par ricochets de donner à voir aux autres pays négociant des licences à coûts conséquents, quelles conditions sont débattues pour la France, et sur quelles bases, donc, leurs propres négociations pourraient se construire.
À bien y regarder, un tel changement de nos pratiques n’est pas un problème d’outil puisque les instruments du type « consultation collaborative » ne manquent pas, sont simples à déployer (ce sont souvent des outils SaaS), tout en étant faciles à prendre en main par leurs utilisateurs finaux.
Ce n’est pas non plus un problème de temps, au sens où la démarche ici proposée serait plus chronophage que la méthode actuelle parce qu’elle supposerait plus d’échanges entre plus de participants : l’exemple de la consultation préalable à la loi pour une République numérique, et les chiffres ci-dessus évoqués, démontrent même le contraire puisque cette masse d’interventions et d’interactions a été obtenue en moins d’un mois, délai particulièrement court.
Ce n’est enfin pas un problème de coûts de mise en place technique : les plateformes existantes proposent en effet leurs services pour des sommes quasi négligeables, eu égard aux montants en jeu dans les négociations ici évoquées.
Non, à y bien regarder, un changement dans nos pratiques de négociation des licences nationales tel que suggéré ici est simplement un choix politique sur la méthode employée pour engager des marchés à plusieurs dizaines de millions d’euros d’argent public, négociations historiquement menées dans une transparence très relative accompagnée d’une confidentialité totalement illusoire, et qu’il est certainement temps de dépoussiérer pour les faire évoluer vers plus de démocratie ouverte.
11. https://www.soundofscience.fr/1754
22. https://www.soundofscience.fr/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-11-COUPERIN-Lettre-accord-Elsevier.pdf
33. En particulier dans un contexte national comme international orienté « Science Ouverte », tout particulièrement dans sa ligne « Open Access », et par rapport également à plusieurs exemples récents de négociations nationales « dures » entre l’éditeur en question et, soit des universités, soit des consortiums, tels qu’évoqués dans The Sound Of Science. On pourra consulter par ailleurs ce billet détaillant certaines des problématiques posées par les dispositions esquissées : http://blog.univ-angers.fr/rj45/2019/04/29/un-accord-de-mauvais-principes/ et cet article proposant une synthèse rapide et mesurée de la problématique générale : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/05/13/embrouilles-a-propos-de-l-acces-aux-revues-scientifiques_5461530_1650684.html
44. Voir par exemple les réactions de la Société française de physique : https://www.sfpnet.fr/prise-de-position-de-la-sfp-sur-les-negociations-avec-elsevier, celle d’Allistene : https://www.allistene.fr/files/2019/04/Contrib_GT_SO_Allistene_NegoElsevier_vfinale.pdf, celle de la SMAI : http://smai.emath.fr/spip.php?breve278 ou celle de CAPSH :
https://blog.dissem.in/2019/lettre-ouverte-au-consortium-couperin-sur-le-renouvellement-de-labonnement
55. Je souligne.
66. Mandat qui vaut lettre de mission en ce qu’il définit les attendus.
77. Cette diffusion restreinte d’informations s’avérant d’ailleurs paradoxale, en ce qu’elle utilise un outil (le mail) qui, en l’espèce, est déjà une porte ouverte à toutes les « fuites » imaginables.
88. On se fera une idée de l’outil en parcourant le site web dédié : https://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation
99. Sans parler du secret des affaires parfois invoqué et protégeant ici des éditeurs en très large situation de monopole, ce qui pose tout de même question.