El último lector
Dans le roman de l’auteur mexicain David Toscana, intitulé El ùltimo lector, un personnage de bibliothécaire pense que toutes les réponses sont dans les livres. Dès lors, on peut utiliser la bibliothèque comme un refuge, ainsi à la bibliothèque de Punta Delgada, dans l’archipel des Açores, « ultramoderne, pimpante voisine d’une vieille église baroque ». Les « nomenclatures énigmatiques » ne préviennent pas la fréquentation assidue de la bibliothèque, « lieu du plaisir gratuit, dégagé de toute forme d’injonction, exonéré de toute obligation, lieu de l’affranchissement ».
The Mexican author David Toscana’s novel El ùltimo lector features a librarian who believes that the answer to everything is to be found in a book. Libraries can be a refuge, like the library of Punta Delgada in the Azores, “the spruce, ultra-modern neighbour to an old baroque church”. “Enigmatic names” do not stop people from becoming regular readers, since libraries are “places for pure pleasure, free from all forms of obligation, exonerated from all duty: they are true sites of emancipation”.
Im Roman des mexikanischen Schriftstellers David Toscana, der den Titel El ùltimo lector trägt, denkt eine Bibliothekarsfigur, dass sich alle Antworten in den Büchern befinden. Infolgedessen kann man die Bibliothek als eine Zufluchtsstätte benutzen, so auch die Bibliothek von Punta Delgada im Archipel der Azoren, „ultramodern, schicke Nachbarin einer alten Barockkirche“. Die „rätselhaften Nomenklaturen“ verhindern die eifrige Benutzung der Bibliothek nicht, „Ort des kostenlosen Vergnügens, frei von jeglicher Form von Anweisung, frei von jeglicher Verpflichtung, Ort der Befreiung“.
En la novela del autor mejicano David Toscana, intitulado El último lector, un personaje de bibliotecario piensa que todas las respuestas están en los libros. Entonces, se puede utilizar la biblioteca como un refugio, así en la biblioteca de Punta Delgada, en el archipiélago de las Azores, “ultramoderna, despampanante vecina de una vieja iglesia barroca”. Las “nomenclaturas enigmáticas” no previenen la frecuentación asídua de la biblioteca, “lugar del placer gratuito, despejado de toda forma de orden terminante, exonerada de toda obligación, lugar del franqueo”.
Dans le très beau roman de l’auteur mexicain David Toscana, intitulé El último lector *, le personnage principal est un bibliothécaire. Il vit et travaille dans le petit village d’Icamole, frappé par la sécheresse et perdu au nord du pays. Un fait divers tragique survient : la mort d’une petite fille. Mais la véritable énigme est le bibliothécaire, Lucio, qui poursuit inlassablement sa mission. Il entend tout sur la littérature et les livres. Le jour de l’inauguration de la bibliothèque, les villageois ne manifestent aucun intérêt pour ce lieu étrange qui prétend les accueillir : « les romans ne racontent que des choses qui n’existent pas, des mensonges » dit un homme. Lucio s’en défend, mais l’homme lui rétorque : « Si j’approche ma main du feu et que je me brûle, je me brûle. Si je prends un coup de couteau, je saigne. Si je bois de la tequila, je me soûle, mais un livre, ça ne fait rien, à moins qu’on me le jette à la figure ! » Rien n’entamera pourtant la détermination de notre bibliothécaire : ni la suppression des subventions gouvernementales, ni la faible, très faible fréquentation de son domaine qui devient, par la force des choses, privé. Son village souffre du manque d’eau, mais lui persiste à clamer que « les livres sont d’autant plus indispensables là où personne ne lit ». C’est un roman : admettons donc que c’est un mensonge et que les livres ne sont pas indispensables, que les bibliothèques doivent fermer quand de moins en moins de monde les fréquente. Mais le livre de David Toscana contient une autre histoire. Le bibliothécaire Lucio ne sort quasiment plus de son établissement, persuadé que toutes les réponses aux questions qui peuvent agiter les habitants du village se trouvent dans les livres. Il lui suffit, pense-t-il, de chercher dans les histoires, de comprendre pourquoi et comment les milliers de personnages qui dorment dans les livres de sa bibliothèque publique ou privée aiment, tuent, se mentent, se rencontrent, s’observent. Donc de passer sa vie à lire sans s’occuper de ce qui est ailleurs que dans les livres. On pourra penser que cette dernière manie vaut pour les bibliothèques personnelles, celle de Proust qui regarde avec nostalgie ses livres d’enfant, celle de Hermann Hesse dont la couverture du livre La bibliothèque universelle, publié par José Corti, représente l’auteur allemand en costume, debout, lisant un livre, accoudé à un des rayons de sa bibliothèque. Mais ce serait occulter le passage, le vrai passage qui consiste à pénétrer dans un lieu public, la bibliothèque, pour y chercher ce que l’on est sûr de trouver ou y trouver ce que l’on ne cherchait pas.
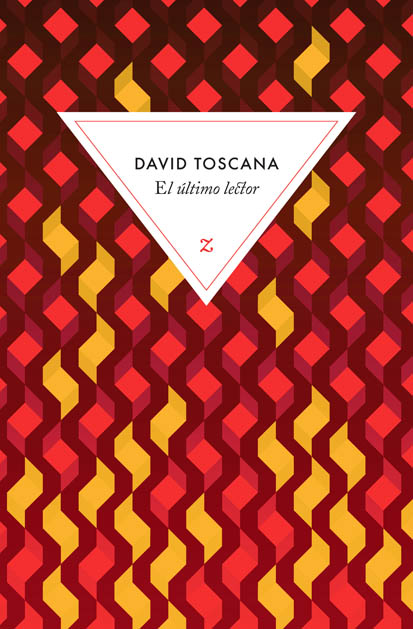
La bibliothèque comme refuge ?
La bibliothèque comme refuge ? Plus encore. Un immense amoureux des livres, Walter Benjamin, voyageur curieux puis émigré itinérant pourchassé par l’avancée des troupes nazies dans toute l’Europe, trouva dans les années trente quelques heures de bonheur à la Bibliothèque nationale de la rue Richelieu. Il y passait ses journées, lisant, écrivant, entouré des millions de livres, lui qui n’a jamais pu transporter sa propre bibliothèque. Mais cherchons la difficulté : point de BnF, point de grandes bibliothèques, et optons pour un petit établissement municipal. Retour à la case départ en somme avec, au dos de la carte de ce jeu de l’oie imaginaire, cet avertissement : « Vous êtes dans une ville inconnue, vous êtes dans la bibliothèque municipale. » L’aventure m’est arrivée un été, il y deux ans. J’étais aux Açores, dans l’île principale de l’archipel, São Miguel, et dans sa capitale, Ponta Delgada. Dans cette ville au taux d’humidité battant tous les records, et dont les maisons colorées évoquent une architecture tropicale, j’ai cherché la bibliothèque municipale. Je la voulais vieille, presque abandonnée, masure proche de l’écroulement, hérissée de plantes grimpantes et recluse au fond d’une rue en hauteur. Je m’imaginais des murs blancs, des étagères rongées d’humidité et même, pourquoi pas, je me voyais enjambant quelques lézards endormis au soleil, intrigués par un visiteur inattendu. C’était un rêve, presque une image de roman, donc un mensonge. La bibliothèque était en réalité ultramoderne, pimpante voisine d’une vieille église baroque. En longeant un grand couloir puis en gravissant un escalier, on accédait à la salle de lecture. Dans une vitrine, trônaient quelques exemplaires originaux de la revue Orfeu, de Pessoa. Dans la salle, où travaillaient quelques étudiants, j’ai longé les rayonnages, sans quête précise. C’est dans cette errance que l’esprit vagabonde avec plus de liberté. Je ne me suis pas occupé du classement : peu importe, puisque je suis le visiteur sans but précis. Mes yeux passaient de Minhas Memórias de Salazar, par Marcelo Caetano (sûrement un grand moment d’hagiographie démocratique) à Hegel : Estética aux éditions Guimarães Editores – Lisboa. Mais je tombais aussi, dans le rayon Filosofia, sur Léon Robin : La pensée grecque et les origines de l’esprit scientifique, collection « Évolution de l’humanité », Albin Michel. Mieux encore : Maurice Block, Dictionnaire général de la politique, tome II, Paris, O. Lorenz, libraire-éditeur, 1874. Avec cette cote : SL 32 (038) B 61 d. Je me suis demandé comment diable ce livre avait pu atterrir dans cette bibliothèque perdue au milieu de l’Atlantique. Mais il n’y a pas de hasard : dans cette île où les grands navigateurs avaient fait escale, il était normal qu’en ouvrant le gros volume, je tombe sur un article de Jacques de Boisjoslin sur la Renaissance. La reliure en cuir noir semblait narguer le temps et adresser un défi à un livre situé plus loin qui traitait du World’s Mass Media. Nous y voilà ! Un quotidien, en libre accès lui aussi, contenait un article sur les nouvelles technologies et je songeais à ces livres que les Japonais lisent sur leur téléphone portable. L’article de ce Jacques de Boisjoslin ne serait certainement pas lisible sur un petit écran. Qu’y ferait-il d’ailleurs, lui cet ancêtre « publiciste », comme on disait à l’époque ? Et comment la Renaissance parviendrait-elle à se glisser entre les cristaux liquides, sauf à admettre que les grands navigateurs du XVe siècle auraient su trouver le passage reliant leur époque à la nôtre ?
Les nomenclatures énigmatiques
Dans cette histoire, le hasard n’a pas sa place car, bien qu’en vacances, je devais justement me documenter sur la Renaissance. Par un acte dont je laisse aux spécialistes le soin de définir s’il a été commandé par un quelconque cheminement inconscient, j’ai donc dû chercher, presque à mon insu, un ouvrage sur cette période que je trouvais finalement, bien que ne le cherchant pas réellement, et en ¬français de surcroît. La bibliothèque municipale de Ponta Delgada me rappelait donc ce grand principe : malgré les cotes mystérieuses, les nomenclatures énigmatiques, les chiffres de monsieur Melvil Dewey, on vient dans une bibliothèque pour trouver ce qu’on ne cherche pas mais qu’on sait répondre à un désir. Règle de vie, règle de lecture, règle de l’otium dont pouvaient jouir les hommes du XIXe siècle. Et de penser à Jean Jaurès qui, chaque jour, arpentait la bibliothèque de l’Assemblée nationale, pendant une heure, maraudant dans les rayons et prenant un livre au hasard, sans doute pour oublier les répliques de Maurice Barrès qu’il avait affronté quelques minutes auparavant. Gérard Genette écrit dans Bardabrac : « Je mis jadis plus d’un an à trouver l’entrée de la bibliothèque de la rue d’Ulm, et plusieurs heures la sortie de celle de la Sorbonne, plus labyrinthique que de raison. Depuis, je rêve parfois que je marche dans une rue de Paris dont les façades haussmanniennes se transforment peu à peu en rayons de livres superposés et alignés à l’infini, chaque étage devenant un rayon, chaque fenêtre un dos de livre. Je cherche une adresse, et ne trouve qu’une cote – celle, vide, d’un ouvrage manquant à sa place, et je me réveille en sursaut devant son “fantôme”. Ce cauchemar est injuste, car le plaisir propre à la bibliothèque est précisément d’y trouver ce qu’on n’y cherchait pas, et vice versa. »
Le lieu du plaisir gratuit
Ainsi, la bibliothèque publique serait bien, aussi, le lieu du plaisir gratuit, dégagé de toute forme d’injonction, exonéré de toute obligation, lieu de l’affranchissement : y venir pour lire ce qu’on y cherche mais également y flâner pour fouiller, tomber sur un livre d’aventures, une bande dessinée, un vieux Jules Verne, un récent Jean Rouaud, un éternel Melville, un Gracq au balcon, un inattendu Graham Greene, un surprenant Larousse ménager illustré, et pourquoi pas un livre d’heures aux somptueuses enluminures de Jean Fouquet (ne devrait-il pas être en réserve ?), cet artiste dont parle Marcel Proust qui lui-même avait quelque difficulté à se familiariser avec le « téléphonage » et qui n’aurait donc pas lu sur un téléphone portable. L’œil aviserait-il un dictionnaire des synonymes du XIXe siècle ? Retenons cette hypothèse. À l’entrée n° 728 d’une édition de 1823 (Garnery, librairie, rue du Pot-de-fer, n° 14), correspondant à « Littérature, érudition, savoir, science, doctrine », on lit : « La littérature fait les gens lettrés ; l’érudition fait les gens de lettres ; le savoir fait les doctes ; la science fait les savants ; la doctrine fait les gens instruits. » L’entrée n° 729, correspondant à « livre », n’évoque que la monnaie, stipulant que « livre » et « franc » ne sont plus « aujourd’hui synonymes ». Imaginons des lecteurs tombant sur la définition proposée par l’entrée n° 728 : un jeune étudiant haussant alors les épaules devant de telles formulations bien académiques, une retraitée (les femmes lisent plus que les hommes) s’amusant de telles inepties, elle qui n’a pas de diplômes mais qui est bien plus instruite que certains diplômés. L’étudiant se demandera si l’érudition peut aider à séduire les filles, la retraitée s’interrogera sur cet étudiant qui lit en face d’elle et qui hausse les épaules. Car nos deux exemples fréquentent la bibliothèque municipale, ils ont leur carte, leurs habitudes, et n’omettent pas de lever les yeux sur leur vis-à-vis puisque « les gens instruits » ne doivent pas considérer que la lecture évacue la vraie vie. Insidieusement – nos deux exemples en sont les heureuses victimes – les tables et les rayonnages projettent un univers, exhalent un parfum de papier, celui friable des années quarante ou celui, glacé, d’aujourd’hui. Rien n’interdit de penser que la lumière des quelques écrans vienne compléter celle des lampes. Nos deux lecteurs se sentent tour à tour exaltés, enfouis, un peu abrutis même si la lecture dure trop longtemps. Ils sortiront de la bibliothèque, municipale, intercommunale ou médiathèque avec un sentiment de liberté dont ils comprendront qu’il leur a été conféré par ces moments passés dans cet espace préservé. Ont-ils lu des mensonges parce qu’ils ont lu des romans ? Croient-ils que toute réponse est dans les livres comme le pensait le bibliothécaire mexicain, personnage de roman, donc personnage fictif ? Songent-ils aux baleines des Açores en lisant Tabucchi, au débat sur les retraites auquel a participé Jean Jaurès en 1910, au suicide de Walter Benjamin en 1940 à Port-Bou ? Parions qu’ils ont échappé à ce « monstre délicat », celui qui hante les vies quotidiennes, cet « Ennui » dont parle Baudelaire dans ces Fleurs du mal que je lis et dont l’étiquette à moitié effacée sur le dos laisse apparaître le chiffre, incomplet, « 08 ». Je n’ose imaginer que mon arrière-grand-père, bibliothécaire lui-même à Sens, ait oublié de le rendre après emprunt…
Septembre 2010
