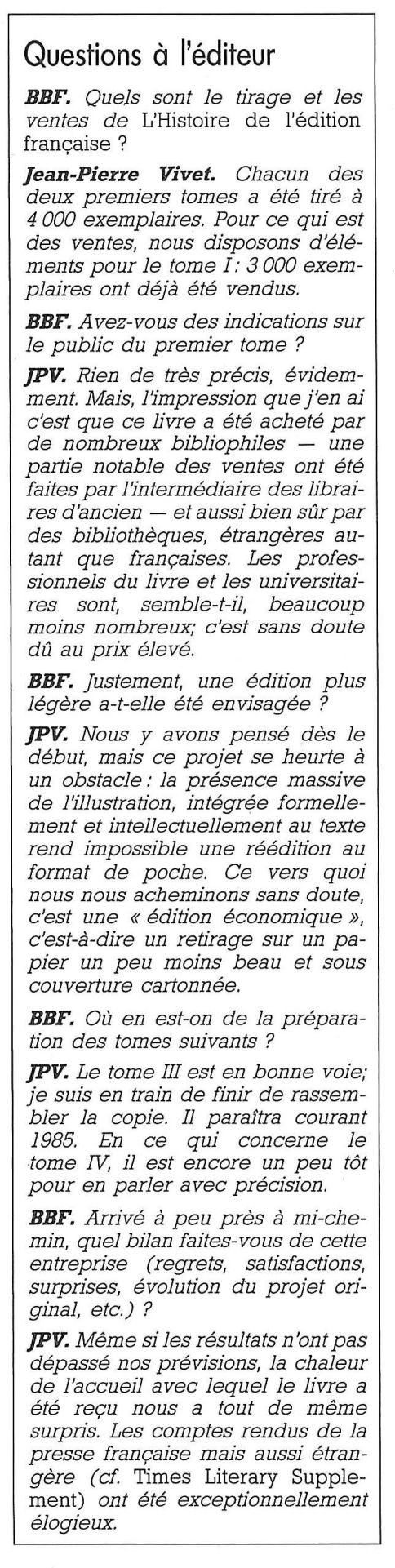Le livre des livres
Entretien avec les auteurs
La genèse de l'Histoire de l'édition française est retracée à travers les différentes approches, le choix des collaborateurs français et étrangers (conservateurs de bibliothèques et universitaires) et les dates charnières qui ont présidé au découpage de chaque tome. Sont tour à tour évoqués l'évolution du rôle de l'éditeur, de ses rapports avec l'auteur, les différentes pratiques de lecture, les rapports entre le pouvoir et l'édition, ainsi que l'évolution conjointe, puis la séparation des éditions du livre et de la presse. Les 2 premiers tomes parus, sur les 4 prévus, ont suscité des réactions et les retombées de cette entreprise sont déjà sensibles.
The birth of the Histoire de l'édition française has been recalled through the various approaches, the selection of the French and foreign joint authors (librarians and searchers), and the main dates that give the frame of each volume. After a survey of the development of the publisher's part and his communication with the author, come a study of different reading methods, a description of the relations between the authorities and the publishing world, and, at last, of the common then separate development of book publishing and press.
L'histoire de l'édition française * vient de publier son deuxième volume, Le livre triomphant. A cette occasion le BBF a interviewé les trois maîtres d'œuvre de cette série, Roger Chartier, Henri-Jean Martin, Jean-Pierre Vivet. L'approche de la nouvelle histoire, qui replace le livre et la lecture dans leur contexte institutionnel, économique et culturel, propose aux bibliothécaires une autre manière d'appréhender les problèmes du patrimoine.
Un éditeur en quête d'auteurs
BBF. Commençons par le commencement : comment une telle entreprise a-t-elle trouvé un éditeur ?
Roger Chartier. Il faudrait inverser la question : comment un éditeur qui voulait publier une histoire de l'édition française a-t-il trouvé des historiens pour la faire ? Car l'initiative vient de Jean-Pierre Vivet; publiant des instruments de travail et des revues concernant les métiers de l'édition, il avait depuis longtemps le projet de faire une sorte d'histoire généalogique du métier d'éditeur, de comprendre les formes anciennes du rôle de l'éditeur et du processus d'édition. Après des contacts en plusieurs temps, il nous a confié, à Henri-Jean Martin et à moi, la responsabilité scientifique et intellectuelle de l'ouvrage. Jean-Pierre Vivet a donc eu l'idée de départ et, par la suite, il a joué un rôle important dans la réalisation même des volumes. D'abord c'est lui qui a fait les index; c'est un travail extrêmement long et minutieux qui a permis de vérifier un certain nombre de choses - les hétérogénéités dans la graphie des noms propres, par exemple - et d'aboutir à des index d'usage, conçus pour servir véritablement d'instruments de travail. D'autre part, il a relu tous les articles et nous avons revu avec lui tous les problèmes de transformation des titres, de redécoupage des articles, etc. Le problème qui s'est posé à chaque fois, c'est que les textes étaient trop longs. Il était, en effet, extrêmement difficile de donner des indications précises aux auteurs : comment maîtriser à l'avance la matière au point de pouvoir anticiper sur la longueur idéale pour un article donné ?
BBF. Et les choses étaient compliquées, on peut l'imaginer par le choix qui a été fait d'une présentation très élaborée, avec une illustration très abondante ?
RC. Oui, au départ, l'idée a été qu'il fallait donner une grande part à l'illustration et que ce livre, qui se voulait une histoire en hommage à l'édition, devait être lui-même un objet qui fasse honneur à l'édition. La maquette et la mise en page ont été confiées à Pierre Faucheux qui a proposé ce rythme à six colonnes, qui donne une grande souplesse dans la répartition du texte et de l'illustration. Donc tout cela, toute cette masse de manuscrits et de documents iconographiques, a demandé un énorme travail de recherche mené par M.H. Besnier et de coordination qui a reposé sur une petite cellule d'édition.
Il y a un autre jeu de miroir entre ce qu'est le livre et ce dont il parle : dans l'ouvrage, on a donné une place assez importante, pour chaque époque, à la réflexion sur les formes du livre, la reliure, la place de l'illustration, sur les rapports entre histoire du livre et histoire des formes esthétiques. Je pense que par des articles comme ceux de R. Laufer, de A.M. Bassy, de J. Toulet ou de G. Barber, on a ouvert là un champ de recherche original.
Fertilisations croisées
BBF. Donc, Jean-Pierre Vivet a proposé d'entreprendre cette histoire de l'édition. Comment avez-vous conçu cette histoire, quel a été votre projet intellectuel ?
RC. Notre projet fondamental a été d'essayer de croiser, autour du processus d'édition (plutôt que de l'éditeur qui est une figure plus récente que l'édition elle-même), les différentes approches actuelles sur l'histoire de l'imprimé. D'un côté, on s'est efforcé de faire le point sur tout ce qui relève de l'histoire de la production du livre, les techniques, les conditions politiques de cette production, l'analyse de sa conjoncture. C'est là le secteur le mieux repéré : il s'agissait donc de donner une synthèse accessible de cette masse de travaux, et notamment des analyses sérielles de la production et de la distribution du livre. Le second volet consistait à donner une place importante - et c'est un des aspects de l'ouvrage qui a le plus retenu l'attention - à une autre approche qui s'attache, elle, aux formes d'appropriation de l'imprimé. Là, on pouvait s'appuyer sur des modèles intellectuels venus de deux disciplines : d'une part, les travaux de sociologie culturelle qui, pour l'époque contemporaine, s'interrogent non seulement sur la distribution de la lecture (qui lit ? combien de livres ?) mais aussi sur les relations des lecteurs avec ces objets possédés ou maniés; d'autre part, certaines analyses de l'histoire littéraire qui, sortant de la tradition selon laquelle il y a des sens internes aux textes, considèrent que les sens sont construits dans la relation de lecture et donc varient selon les lecteurs, selon les groupes sociaux, selon les outillages mentaux, selon les époques.
Il nous est apparu que l'édition -ou le processus d'édition - est à la charnière de ces deux types d'approche, puisqu'elle suppose à la fois tout un ensemble de conditions technologiques, politiques, sociologiques avant que le produit soit publié, et ensuite, elle implique forcément des rapports avec des clientèles et leur usage du produit fini, qu'ils soient dictés par l'activité professionnelle, le plaisir, la méditation ou la prière, la collection, ou tout ce que l'on voudra... Ce qui était important pour nous, c'était de désenclaver ces différentes approches, de les faire se rejoindre.
BBF. Et vous avez traduit ce souci dans le choix des collaborateurs de l'ouvrage ?
RC. Bien sûr. Ces orientations se retrouvent dans la composition du collectif d'auteurs. Nous avons délibérément couru le risque d'avoir des contributions très différentes non seulement par le style d'écriture mais aussi par le style de pensée. Nous avons préféré la marque de ces voix différentes à une écriture « encyclopédique », banalisée. Nous avons donc rassemblé des gens qui sont habituellement, et arbitrairement, séparés en partie par le fait que les institutions auxquelles ils appartiennent ne communiquent pas très aisément entre elles : d'un côté des conservateurs de bibliothèques, dont la démarche est fondée sur la familiarité et la connaissance immédiate des objets qu'ils conservent, cataloguent et étudient; de l'autre, des universitaires venus de l'histoire sociale, de l'histoire de la culture et de l'histoire de la littérature qui, beaucoup moins familiers de l'objet, utilisent les analyses de la circulation de l'imprimé dans le cadre d'une réflexion plus globale sur les partages culturels dans les sociétés anciennes.
Le deuxième souci a été de donner aux chercheurs étrangers la place qui leur revient, étant donné que beaucoup d'impulsions, de recherches novatrices sont venues de collègues étrangers travaillant sur l'édition en français. R. Darnton est le plus connu mais il y en a d'autres. Leur apport, notamment pour le XVIIIe siècle, a consisté à analyser la production non pas à travers les sources officielles (comme l'ont fait généralement les historiens français), mais à s'intéresser à la production hors de France, hors d'atteinte de la censure royale.
BBF. Est-ce que cette place importante des chercheurs étrangers est une originalité de l'histoire de l'édition ?
RC. Non. J'ai l'impression que dans tous les domaines il y a beaucoup de chercheurs étrangers ; peut-être y a-t-il plus d'historiens de la France aux Etats-Unis qu'en France, par exemple. L'originalité réside plutôt dans le fait que les historiens du livre sont mieux intégrés dans la communauté des chercheurs français que d'autres : ainsi des historiens comme P. Saenger, R.H. et M.A. Rouse, parmi les médiévistes ou R. Darnton ou J. Rychner parmi les dix-huitièmistes, pour ne citer que quelques exemples. Je crois que cette intégration est favorisée par le fait que l'histoire de l'imprimé, quel que soit le mode d'approche, suppose les mêmes instruments, les mêmes références, la même fréquentation de la Bibliothèque nationale (en particulier de la Réserve des imprimés), où tous ces chercheurs se retrouvent; ils se connaissent donc bien.
Histoire sans frontières
BBF. Dans le même ordre d'idée, la restriction géographique présente dans le titre est souvent débordée. Pourquoi ?
RC. En effet, le titre exact serait Histoire de l'édition en français, mais cela n'aurait pas fait un très bon titre, vous en conviendrez. Etudier les livres édités en français implique forcément de s'intéresser aux lieux d'impression hors de France: R. Darnton pense qu'au XVIIIe siècle, un livre sur deux en français était imprimé hors de France. Et ce phénomène existe aussi au XVIe comme au XIXe siècle. Cette édition peut être une pure duplication des éditions faites en France, lorsqu'il s'agit de contrefaçons, et dans ce cas, son intérêt est purement commercial. Lorsqu'il s'agit de l'édition d'autres titres, de livres qui ne peuvent être publiés dans le royaume, leur étude est importante pour l'histoire intellectuelle. On a donc essayé d'accorder une place importante à cette production, surtout dans le tome II. Des articles concernant l'Italie et l'Espagne et des encadrés sur le Québec et la Russie donnent également un aperçu sur la circulation des livres en français hors de France. Et puis, on peut poser la question sous un autre angle et se demander jusqu'à quel point on peut généraliser les descriptions qui ont été données ici des modalités de l'édition française. Bien sûr, le cadre technologique varie assez peu d'un pays à l'autre, mais d'autres faits sont eux très directement liés soit à un champ culturel, soit à une situation politique : la condition de l'auteur, le rapport entre l'auteur et le pouvoir, par exemple. Sur ces thèmes, jusqu'à quel point les phénomènes que l'on pourrait observer dans d'autres pays seraient-ils analogues ou, au contraire, différents ? La question est posée.
Justement, l'« American Antiquarian Society » a le projet de faire une histoire de l'édition en Amérique du Nord de la période coloniale jusqu'au milieu du XIXe siècle, assez proche de la nôtre dans ses orientations, sinon dans sa forme. Cela fera un point de comparaison.
Histoire à épisodes
BBF. Quelles sont les grandes ruptures que vous avez voulu mettre en évidence ? Car le découpage des tomes fait apparaître une chronologie qui a son rythme spécifique.
RC. Oui, c'est vrai; le processus d'édition met en jeu des déterminations extrêmement diverses et on ne peut appliquer à son histoire, ni une conjoncture strictement politique, même si une des dates charnières, 1660, est une date politique, ni une conjoncture strictement économique : les phases A et B de Simiand ne s'adaptent pas forcément à la production du livre. Le milieu du XVIIe siècle voit la réorganisation de l'édition en France, avec la redistribution des cartes entre Paris et la province, sous la pression politique; 1830 correspond à une rupture technologique assez nette, c'est le moment où le travail de l'atelier se transforme et où commence à émerger la figure moderne de l'éditeur; 1950 marque la période où la forme du livre se modifie, avec le développement du livre de poche, et où le livre se distribue par d'autres canaux que les librairies (clubs de livres par exemple).
BBF. De ce point de vue, le volume II se différencie du premier tome par son caractère, en quelque sorte, statique. La période 1660-1780 a-t-elle vu peu d'évolutions marquantes ?
RC. Effectivement, on a l'impression, entre 1660 et 1780 (et pas 1789), d'une période assez homogène : il n'y pas de grande transformation technologique, ni de modification fondamentale du rapport du monde de l'édition avec le pouvoir royal; le contrôle est plus ou moins laxiste, le mécénat royal est plus ou moins marqué. Il y a bien sûr des infléchissements dans l'équilibre de la production, mais sans qu'il soit possible de les organiser autour d'une ou de plusieurs dates charnières. On a arrêté cette période à 1780 - aux Edits de 1777 en fait - pour marquer que les innovations de la période révolutionnaire, souvent très temporaires, étaient déjà présentes, dans leurs grandes orientations, à la fin de l'Ancien Régime.
BBF. Vous avez évoqué la coupure de 1950; cela nous amène aux volumes à paraître. On a parlé d'un troisième volume : où en est la question ?
RC. En effet, au départ, on avait prévu un troisième volume qui achèverait l'ouvrage en traitant la période de 1830 à nos jours. Mais on s'achemine vers deux volumes : le tome III qui couvrira 1830-1950 et le tome IV qui ira de 1950 à 1985. Il faut d'abord dire que notre savoir sur l'histoire de l'édition est presque inversement proportionnel à la chronologie. Les deux premiers volumes traitent de siècles pour lesquels les travaux sont nombreux; on pouvait donc mobiliser rapidement des collaborateurs susceptibles de présenter un bilan. Plus on se rapproche de notre époque, moins on a de travaux sur lesquels s'appuyer. Le volume III partira des grandes transformations technologiques et s'arrêtera avant le développement de nouvelles formes, le livre de poche, les clubs de livres. On retrouvera le même type d'organisation que dans les deux tomes précédents : un ensemble de contributions de spécialistes, bibliothécaires ou universitaires.
BBF. Le titre annoncé est « Le livre concurrencé ». Concurrencé par qui, ou par quoi ?
RC. C'était le titre annoncé dans l'hypothèse, première, d'un seul volume pour achever l'ensemble; c'était un vieux reste de mac luhanisme : la première forme de concurrence étant constituée par le développement de la presse, et la seconde par l'essor des médias de l'écoute et de la vision. Mais maintenant, il faut trouver d'autres titres. Pour en revenir au dernier volume, qui traitera donc de l'édition française à partir des années soixante, il aura une allure vraisemblablement un peu différente des tomes précédents. Ce qui est projeté c'est d'abord une analyse de l'édition à l'échelle macroscopique, puis des monographies éditoriales (histoire, fonctionnement, collections, succès), et l'idée est aussi de recueillir des témoignages, écrits ou oraux, d'un certain nombre de praticiens de l'édition qui pourraient dire comment ils ont pensé et vécu l'évolution des années 45 à 85. Voilà donc où en est la réflexion sur le volume N, mais rien n'est encore décidé.
Le couple auteur/éditeur
BBF. Vous avez à plusieurs reprises indiqué que la figure de l'éditeur telle qu'on la conçoit de nos jours s'est constituée tardivement. Pouvez-vous préciser ?
RC. Oui. De même que, contrairement à l'association qui se fait presque automatiquement dans la tête des gens, on peut parler de livres avant l'invention de l'imprimerie, de même on peut observer des processus d'édition, très différents certes, pour les manuscrits. Il ne serait pas juste pour autant de penser que le terme d'éditeur peut s'appliquer à l'ensemble des siècles que nous étudions. La grande rupture s'est produite dans la seconde moitié du XIXe siècle : c'est à ce moment qu'apparaît l'éditeur moderne, c'est-à-dire quelqu'un qui, détaché du commerce de détail et de l'imprimerie, donne tout son temps à la constitution de son fonds, à la négociation avec les auteurs et à la commercialisation de ses livres. Il est donc très différent de l'éditeur ancien qui était souvent un libraire, parfois un imprimeur, et qui vendait non seulement son fonds, mais aussi d'autres livres qu'il avait achetés ou obtenus par échange.
BBF. Il y a un personnage qui prend une place importante dans le tome II, alors qu'il apparaissait peu dans le premier volume, c'est l'auteur. Pourquoi ?
RC. Effectivement, il y a une évolution significative au cours du XVIIIe siècle. Auparavant, la plupart des auteurs vivaient dans le système du mécénat : ce qui est important pour eux, est d'obtenir des gratifications, des places, éventuellement des commandes, mais leur existence matérielle n'est pas liée au profit de l'édition de leurs écrits. A partir du XVIIIe siècle, la situation change, les auteurs veulent ou doivent s'émanciper du mécénat, et donc vivre de leur plume : la question de la propriété littéraire et du droit d'auteur se pose, le problème de la négociation financière avec l'éditeur devient dominant. C'est un basculement total; les rapports entre auteurs et éditeurs sont gouvernés par cette idée nouvelle que c'est l'auteur qui a la propriété matérielle et intellectuelle de ses écrits, et la figure de l'auteur prend place dans notre histoire... Car, si la notion d'auteur est permanente dans une histoire des textes, dans une histoire de l'édition l'auteur n'apparaît que lorsqu'il devient un partenaire important dans le jeu éditorial. On ne peut parler d'auteurs, au sens moderne, que lorsqu'on peut parler de propriété littéraire et de droits d'auteurs.
Ce vice impuni, la lecture
BBF. Un des apports importants de cette Histoire de l'édition nous semble être le développement d'une histoire de la lecture, conçue comme un ensemble de pratiques complexes en constante évolution.
RC. Jusqu'à maintenant, on avait appréhendé l'histoire de la lecture essentiellement sous l'angle de l'alphabétisation. L'ensemble de ces études reposait sur le comptage des signatures dans divers documents, registres paroissiaux et contrats de mariage principalement; on en tirait des conclusions sur les capacités de lecture et d'écriture dans les sociétés anciennes. Or, c'est un taux minimal de gens pouvant déchiffrer qui est mesuré ainsi : la signature relève de l'apprentissage de l'écriture et, dans la société traditionnelle, une partie des populations pouvaient avoir une certaine maîtrise de la lecture sans pour autant savoir écrire, ni même signer. Il y a plus de lecteurs potentiels - et de lectrices - que de signants.
On peut déduire de ce premier constat que tous ces lecteurs n'ont pas la même capacité de lecture; et ce qu'il faut essayer de construire est une histoire de cette gamme de compétences à l'intérieur de ce que nous appelons « lire ». Ces compétences se différencient d'abord par des modalités physiques : lecture avec subvocalisation ou oralisation, lecture silencieuse. On peut reprendre également l'opposition fréquemment utilisée par les historiens allemands ou américains entre lecture intensive et lecture extensive. La lecture intensive désigne la familiarité avec quelques textes, sacrés ou pratiques, qui sont déchiffrés, oralisés et mémorisés. La lecture extensive au contraire, s'attache à un grand nombre de textes, la lecture est alors émancipée des autres pratiques culturelles et s'exerce dans un contexte de la multiplication des usages du livre.
Un autre champ de recherche consiste à tenter de restituer des pratiques de lecture réelles: comment lit-on ? où lit-on ? solitairement ou collectivement ? chez soi ou dans un espace public ? Cette histoire des pratiques sociales de la lecture amène finalement à s'interroger sur l'utilisation mentale, intellectuelle, culturelle qu'un lecteur, ou un groupe de lecteurs, fait de ses lectures, lorsque les sources le permettent.
BBF. Quelles sont, justement, les sources d'une telle histoire ?
RC. A mon avis, elles sont de trois types. Il y a, d'une part, ce que j'appellerai les confessions individuelles : à l'époque contemporaine on dispose de celles, provoquées, des enquêtes sociologiques, mais si on remonte les siècles, on peut aussi trouver des témoignages, des confessions extorquées (quand l'Inquisition demande aux gens ce qu'ils croient, elle leur demande aussi ce qu'ils ont lu), etc. Les utilisations les plus réussies de cette première catégorie de sources sont sûrement le livre de Carlo Ginzburg Le Fromage et les vers à partir du procès d'un meunier frioulan du XVIe siècle que l'on interroge sur ses lectures, et une étude récente de Robert Darnton sur un négociant rochelais qui s'explique sur ses lectures de Rousseau dans une correspondance avec le Directeur de la Société typographique de Neuchâtel, son ancien précepteur. La deuxième série de sources est constituée par les représentations, iconographiques ou littéraires, des pratiques de lecture, qui, lorsqu'on les comprend précisément comme des représentations, offrent un vaste champ d'investigation.
Et enfin, la dernière source, c'est l'imprimé lui-même, à partir duquel on peut entreprendre une sorte de reconstruction archéologique : tenter de lire sur les matériaux imprimés-mêmes les lectures et les usages possibles, voulus par les auteurs et les éditeurs et permis par les compétences culturelles des lecteurs telles qu'on peut les appréhender à l'échelle macroscopique.
Cette histoire des pratiques de lecture n'est pas susceptible, du moins immédiatement, du même type de traitement quantitatif, statistique, que l'histoire de la production ou de la circulation du livre, mais elle peut se bâtir à la croisée d'une approche macroscopique - les compétences culturelles dans les sociétés de l'Ancien Régime - et d'approches microscopiques - l'analyse par groupe ou par individu des pratiques de lecture. C'est un domaine ouvert...
Le livre en permissions
BBF. Vous évoquiez à l'instant les études quantitatives de la production de livres. Quelles sont les sources utilisées par ces travaux ?
RC. Une des synthèses que l'on a essayé de mener d'un bout à l'autre de l'ouvrage a consisté à donner fragment par fragment, depuis le temps des manuscrits, une conjoncture de la production du livre. Bien sûr les sources ne sont pas les mêmes à toutes les époques. Avant le XVIIIe siècle, les études s'appuient sur la production conservée, pour la production des manuscrits comme pour le travail de H.J. Martin sur le livre à Paris au XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, il est possible d'utiliser les registres de privilèges et de permissions et enfin, depuis le XIXe siècle, on dispose de la Bibliographie de la France.
Le raccord entre toutes ces séries est évidemment difficile à faire puisqu'elles ne mesurent pas tout à fait la même chose. A partir de la production conservée, on obtient des résultats à revoir en hausse - on peut penser que pour certains livres, on n'a plus un seul exemplaire - alors que les comptages de permissions pêchent plutôt par excès, l'obtention d'une permission ou d'un privilège n'étant pas toujours suivie d'une publication effective. La Bibliographie de la France est, elle, une donnée plus objective.
D'autre part, aucune de ces sources ne prend clairement en compte, pour l'ancien régime typographique, la production des contrefaçons et des livres interdits. On ne peut avoir là de séries statistiques continues; on en est donc réduit à des compléments de type monographique portant sur des lieux spécialisés dans ce type d'impression (c'est ainsi qu'il y a, dans le volume II, un article sur Avignon), ou à l'analyse de sociétés typographiques dont les archives sont particulièrement bien conservées, ainsi à Bouillon et surtout à Neuchâtel...
BBF. L'étude des rapports entre le pouvoir et l'édition est un des fils conducteurs du tome II. Quelles sont les nuances à apporter à la vision un peu manichéenne qu'on a pu conserver de l'époque des Lumières vue par l'histoire littéraire traditionnelle ?
RC. En effet, le volume II s'ouvre sur la transformation des formes d'intervention du pouvoir monarchique sur l'édition. D'autre part, les rapports entre le pouvoir royal et les auteurs au XVIIIe siècle ont souvent été vus à travers les démêlés de Voltaire, Rousseau, Helvetius et d'autres avec la censure. Nous, nous nous sommes efforcés de montrer deux choses. D'abord, l'intervention royale sur le livre ne se limite pas à la censure, elle prend d'autres formes comme la collection (la Bibliothèque du Roi) ou l'édition (l'Imprimerie royale).
Le système des privilèges et le soutien donné aux éditeurs et aux libraires parisiens aux dépens des provinciaux est un mode de contrôle, certes, mais c'est aussi un mode de redistribution de l'activité économique.
Ensuite, il faut se libérer de cette image de la monarchie persécutrice de l'édition; les choses sont infiniment plus complexes que cela : il y a eu souvent des compromis entre les autorités politiques et l'édition des Lumières, compromis qui excluaient évidemment l'intolérable, c'est-à-dire les textes pornographiques, ou violemment anti-religieux, ou s'attaquant au Roi et à la Cour. Il y a eu un jeu d'équilibre entre des périodes où l'on poursuivait les textes éclairés et d'autres où l'on inventait des formes nouvelles de permissions, tacites ou orales, pour tolérer la circulation des livres édités en français hors du royaume. Malesherbes est le représentant typique de cette politique d'équilibre. Et il faut dire aussi que le personnel ministériel de l'administration de la Librairie participe pleinement de l'idéologie des Lumières; il n'est donc pas étonnant qu'il ait été en permanence à la recherche d'un compromis. La ligne de partage entre le tolérable et l'intolérable passait entre ce que nous entendons, nous, par textes philosophiques -qui étaient très largement tolérés par la monarchie - et ce que les éditeurs, les helvétiques en particulier, appelaient « livres philosophiques », c'est-à-dire des séries de pamphlets, des libelles extrêmement violents, très pornographiques qui attaquaient la monarchie à travers la description des pratiques immorales du Roi et de la Cour. Ce qui était intolérable aussi, évidemment, c'étaient les textes proclamant l'anticléricalisme ou l'athéisme.
Presse/livre
BBF. En 1660, lorsque commence le volume II, le périodique en est à ses débuts. Comment cette forme de l'imprimé se détache-t-elle du livre ? Quelle place allez-vous lui donner par la suite ?
RC. Le périodique a évolué très vite : des formes sont apparues, qui remplissaient des fonctions étrangères au livre - je pense à ces périodiques utilitaires qu'étaient les petites affiches. La période de la Révolution française, en mettant en place la fonction politique du périodique, a marqué le début d'une émancipation qui s'est poursuivie au XIXe siècle avec des supports techniques nouveaux; c'est en effet dans les imprimeries de presse qu'ont été réalisées les grandes innovations technologiques. Une seconde rupture se marque ainsi avec le livre : alors que celui-ci connaît encore des tirages proches de ceux de l'Ancien Régime, la presse pratique une production de masse. Ce qui a donc été décrit dans le volume II de l'Histoire de l'édition, c'est le début de la séparation entre l'édition du livre et celle de la presse, c'est-à-dire l'émergence de la fonction politique de la presse avec la Révolution. Auparavant leurs histoires étaient tout à fait conjointes dans leurs formes, dans leurs contenus et dans leurs éditeurs - Panckoucke, par exemple, éditait aussi bien des périodiques que des livres et les périodiques étaient aussi vendus sous la forme de fascicules annuels, donc de « livres ».
La place faite au périodique dans les deux premiers tomes s'explique donc par cette évolution conjointe. Quand nous allons traiter du XIXe siècle, c'est-à-dire d'une période où ces deux systèmes d'édition se différencient fondamentalement, on adoptera une autre formule. Il ne peut s'agir de faire une histoire de la presse -qui existe déjà, d'ailleurs - mais plutôt de faire apparaître des éléments sur l'évolution de cette forme d'imprimés en contrepoint de l'analyse des mécanismes éditoriaux du livre : la presse continuera donc d'apparaître, mais seulement en contrepoint, sous forme d'encadrés, assez copieux sans doute.
De la chaire au kiosque
BBF. Peut-on d'ores et déjà avoir des indications sur les retombées scientifiques de cette Histoire de l'édition ? N'avez-vous pas l'impression qu'elle fait apparaître, pour de bon, une discipline, ou en tout cas un ensemble de recherches, au sens plein du terme ?
RC. L'objet n'est pas nouveau; mais jusqu'à maintenant on avait tendance à considérer que les études sur l'imprimé étaient une discipline pour spécialistes qui faisaient des catalogues d'incunables, ou qui pouvaient repérer la généalogie d'une édition. En dehors du cercle des spécialistes, c'était vu comme un savoir extrêmement cloisonné. Je crois que cet ouvrage a fait apparaître qu'il y avait là un enjeu considérable pour l'analyse de tout système culturel.
Aux historiens de la culture, le livre a montré qu'il ne fallait pas se contenter de mettre en séries des inventaires de bibliothèques ou la production imprimée dans un site donné, mais que, une fois ces distributions repérées, on pouvait affiner l'analyse en considérant qu'un imprimé est susceptible d'usages multiples, par des lecteurs différents ou par un même lecteur placé dans des situations différentes. On a essayé de dépasser certaines naïvetés de l'histoire quantitative qui a souvent pensé qu'il suffisait de lire l'inventaire d'une bibliothèque pour saisir la culture d'un individu ou d'un groupe. Il faut aller vers une analyse plus microscopique des systèmes d'appropriation de l'imprimé.
Du côté des littéraires, il y a eu beaucoup de réactions parce que l'ouvrage renforçait l'idée selon laquelle le sens d'un texte est construit à travers ses lectures et ajoutait une dimension à la réflexion littéraire sur la lecture en faisant ressortir que ce qui était donné à lire, ce n'est pas seulement un texte, mais une « mise en imprimé » de ce texte : quand un même texte circule à travers des formes typographiques différentes, il peut porter des lectures différentes.
Cet accent mis sur le support des textes est un des points qui a suscité le plus d'intérêt. J'ai pu le constater au cours des deux ou trois voyages que j'ai fait aux Etats-Unis depuis la parution du premier volume : les gens qui font de l'histoire des idées politiques, par exemple, ont pris conscience du fait qu'on ne peut pas étudier les textes, sans songer que dans l'appropriation de ces textes, les formes de leur support peuvent avoir une importance aussi grande que le contenu lui-même.
Enfin, il y a une autre série de retombées, je crois, de cette publication, c'est le développement des études sur l'imprimé, en dehors de ses bastions traditionnels - l'Ecole des Chartes, la IVe section de l'Ecole pratique des hautes études, l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires. Des enseignements nouveaux, dans ce domaine, sont en projet dans les universités. Il y aura des travaux d'étudiants, des recueils collectifs qui vont sortir de là, dans les années à venir.
BBF. Les deux premiers volumes ont eu un écho plus large que celui des revues spécialisées. Etait-ce prévisible ?
RC. Pas à ce point. Il est assez paradoxal que ce livre qui est quand même un ouvrage d'érudition n'a pas eu encore beaucoup de comptes rendus dans les revues savantes. C'est imputable pour une part aux délais habituels de réaction de ces revues, mais aussi à la nécessaire étroitesse du service de presse pour un ouvrage de ce coût.
En revanche, le tome I comme le tome II ont été « couverts » par l'ensemble de la presse quotidienne ou hebdomadaire. Et ça, c'est assez surprenant. Je pense qu'il y a vingt ans, on aurait dit « C'est un magnifique monument, mais c'est pour les bibliothèques, on ne va pas en parler... ». C'est la marque, je crois, du fait que l'histoire culturelle a atteint un certain degré de publicité; les débats sur les méthodes pédagogiques, sur l'apprentissage de la lecture, la réflexion sur l'analphabétisme, tout ce contexte a favorisé le rapprochement avec le public.
Des grognards aux Marie-Louise
BBF. Y a-t-il eu des réactions d'équipes de chercheurs dans le domaine de l'historiographie (histoire du XIXe siècle notamment) ? Quelles ont pu être les réactions des éditeurs (ouverture de leurs archives à des chercheurs) ?
Henri-Jean Martin. L'histoire de l'édition au XIXe et au XXe siècles pose en effet des problèmes très différents par rapport aux périodes précédentes. D'abord parce qu'elle a été moins étudiée. N'oublions pas que ce n'est que très récemment par exemple qu'on a pris conscience de sauvegarder de manière plus systématique la production de ces périodes. Dans ces conditions, il nous a fallu faire appel très souvent pour combler les « trous » à des historiens de la société ou de la littérature, en leur demandant d'étudier d'un peu plus près les phénomènes concernant le livre. J'ai l'impression que ces contacts ont été fructueux et auront des prolongements concernant la recherche universitaire. Il nous a fallu aussi organiser des recherches systématiques dans des fonds d'archives encore inexplorées. Nous avons fait également appel aux « Marie-Louise » de l'histoire du livre, c'est-à-dire à des étudiants ou à de futurs bibliothécaires, qui n'avaient parfois pas fini leurs études, mais commençaient à se spécialiser dans le livre des XIXe et XXe siècles. La moyenne d'âge des auteurs sera donc très inférieure dans le tome III à celles des deux premiers tomes.
Concernant d'autre part les archives d'éditeurs, une lettre écrite à ceux-ci a produit quelques résultats. Mais le problème est toujours le même. Il faut là encore prendre des contacts, négocier un accord, car il s'agit après tout d'archives privées, avec tout ce que cela comporte de personnel, et surtout trouver quelqu'un qui puisse étudier les documents. Nous l'avons fait pour certains éditeurs. Nous ne l'avons pas fait pour tous. Nous posons de la sorte, en tout cas, le problème de la sauvegarde de ce type de documents.
BBF. « L'histoire du livre a trop souvent vécu sur une fausse distinction entre ceux qui gardent les livres et les classent et ceux qui les lisent (ou les comptent) pour que l'on ne se réjouisse pas de cette rencontre inédite ». Quelle serait l'orientation à donner à l'enseignement de l'histoire du livre dans les formations des bibliothécaires et des libraires pour que cette rencontre soit suivie de beaucoup d'autres ?
HJM. Il y aurait là dessus beaucoup à dire. Je sais en tout cas ce que l'enseignement de l'histoire du livre ne doit pas être : une hagiographie. Ce qui est souvent, me semble-t-il, le cas à l'étranger. Ceci dit, l'enseignement qu'on doit donner me semble devoir être orienté, selon les types de bibliothèques, dans deux directions :
- faire réfléchir les élèves sur la spécificité des moyens de communication en expliquant, par exemple, comment l'écriture est apparue, ce que sont les systèmes d'écriture, en insistant encore par exemple sur le fait qu'on ne savait pas lire à voix muette avant les XIe-XIIIe siècles, en étudiant la genèse des découvertes de nouveaux moyens de communication, en insistant sur le fait qu'il existe un lien entre la logique d'une société et ses techniques de communication par le biais de la mise en texte, donc en posant des problèmes essentiels pour la société actuelle. Cela est très difficile mais me semblerait fondamental. Cela d'ailleurs s'intègre assez naturellement dans un cours d'histoire du livre donnant un minimum de notions historiques sur l'évolution des idées et des mentalités à travers la production livresque.
- insister plus particulièrement dès qu'on se trouve en présence de bibliothécaires qui auront à s'occuper de conservation sur les documents et en fournir une typologie. Et au niveau le plus élevé (Ecole des chartes, spécialisation de l'ENSB), être plus technique et précis. On ne doit plus oublier par ailleurs que les bibliothèques municipales possèdent le plus souvent des livres anciens. Ceux-ci, on le sait bien, sont parfois négligés et très fréquemment en mauvais état. Il faudrait donc sensibiliser à ces problèmes tout bibliothécaire de lecture publique. Je rappelle enfin qu'on trouve des fonds anciens dans bien des bibliothèques universitaires.
J'ajouterai encore que, en tant que professeur (Chartes et ENSB), je regrette souvent que d'anciens élèves doués se détournent ensuite de toute recherche. J'ai franchi tous les échelons, grades, etc. dans des bibliothèques diverses, en continuant mes travaux: je pense donc que c'est possible. Cela me semblerait utile pour les bibliothèques dès lors qu'il s'agit de l'étude de livres de leur fonds. Ce qui me semble manquer, c'est l'articulation et les incitations nécessaires. Cela est hors de mon ressort, je me borne à poser la question.
BBF. L'histoire des bibliothèques : un phénomène tel que les dépôts littéraires n'a droit qu'à un encadré en fin d'ouvrage. Pourquoi ? Cela correspond-il à la modestie du rôle joué par les bibliothèques dans l'histoire de la lecture ou à l'absence de sources ?
HJM. C'est intentionnellement que l'histoire des bibliothèques n'a été couverte ici que par des « flashes ». Elle devrait faire l'objet d'une autre publication. Un mot cependant au sujet de l'histoire des bibliothèques. Là encore il ne doit s'agir ni d'hagiographie ni de sacralisation de la lecture. Mais on doit ajouter que la France est en retard dans ce domaine. Et cela parce que les étrangers vivent souvent dans les mêmes bibliothèques multiséculaires. En France, les saisies révolutionnaires ont tout bouleversé. D'où les problèmes qui se posent à l'Etat, propriétaire de tant de fonds anciens dispersés. Tout cela devrait être mieux connu, de même que l'histoire de la lecture publique. Il y aurait beaucoup à écrire et à dire sur tout cela. J'espère que ce sera fait un jour... Surtout si tous se mettent au travail.